- J'aime
- E-cinéma
- Donnez votre avis
- Partagez
- prev
- next
Bande-annonce
La presse en parle
Premier chef d’œuvre de fiction de ce festival et qui a sans doute constitué un point de passage essentiel vers Nelly, Les êtres chers ( 2015 ) flirte avec le mélodrame, le frôle, se joue de lui aussi souvent que possible. Moins que les tourbillons et les coups d’éclat d’un Xavier Dolan, Anne Émond préfère la douce beauté de la vie qui va, des jours en famille heureux qui se dissolvent dans l’azur, des engueulades qui se dissipent avec le temps, des regrets et de nos blessures intérieures les moins visibles. Voilà bien le type de film le plus difficile à réussir ! La saga des Leblanc s’articule ici en profondeur le long du cordon invisible père-fille, s’enroule à la mort du père, à la perte symbolique du frère, s’enfonce dans les forêts où l’on se révèle.
Laisser couler, mettre à nu les émotions, jamais forcer. Attendre que nos souvenirs remontent et que nos bleus viennent assombrir cette lumière chaleureuse qui éclabousse la famille Leblanc de ses vertus thérapeutiques. Ce n’est pas une fresque et pourtant… les ellipses dispensées sur deux décennies, des coupes répétées dans la vie de famille ( un talent de la radiographie hérité des plus beaux drames réalistes québécois, tous sous perfusion documentaire ), la perte de l’innocence le temps d’un coup de fusil et le montage, fluide, pas d’une seule eau mais au contraire élaboré à coup de projections tests pour parvenir à l’épure, à un récit rincé par la marée d’après la tempête. L’autre immense qualité est spatiale : la maîtrise de ce territoire rural au cadre en apparence infini, à la nature édénique mais également luxuriante, étouffante où l’on se replie sur son bout de présent, dessine un théâtre naturel où se débattent les marionnettes et les êtres pris dans leurs rets. Il faut donc saluer l’écriture subtile des personnages, la direction remarquable des comédiens, Maxime Gaudette qui joue David, Mickaël Gouin dans le rôle du frère, Valérie Cadieux la mère au sourire impuissant et le soleil du film, Laurence, qui s’épanouit grâce à une jeune comédienne devenue depuis incontournable sur les écrans du Québec, Karelle Tremblay. À tout cela s’ajoutent encore les audaces : fuite du son sur la crise de folie du jeune homme aimé, retour de ce même son avec les oies sauvages, sens de la mesure. Une famille, plusieurs membres, mais une même pulsation. Pour finir, Anne Émond largue les amarres, comme l’on s’imagine qu’elle tourne, au moins, une page. Laurence fuit à Barcelone retrouver la lumière et un dernier billet d’adieu, qui résume toute l’idée que l’Auteure se fait de la nécessité de la transmission. C’est le chant emblématique de Gilles Vigneault, sous ce chêne qui abrite tout un pays et sa mémoire, sa culture commune et qui exprime mieux que tout le déracinement brutal représenté par le suicide du père et le mensonge organisé. II y aurait beaucoup à dire sur ce film bouleversant, dont les rebondissements de sitcom se lovent dans les méandres d’un flux libérant tout comme la débâcle, salvateur. Il vaut en outre pour la majesté de sa photographie ( Mathieu Laverdière, chef opérateur très renommé au Québec, déjà celui de Nuit # 1 ( 2011), mais aussi au festival celui de Maudite poutine ), aussi sobre que limpide, pas crépusculaire mais souvent de fin d’après-midi. Mais il faut d’abord saluer la tranquille révolution de sa mise en scène, qui force le respect même quand tout s’accélère, dérape vers un baroud adolescent. Du cinéma grand public taillé pour les plus grands écrans, à fort potentiel universel et qui à juste titre a fait l’ouverture du festival de Locarno, sans hélas trouver d’écho chez nous. Pour le moment… Il est impossible que la montée en puissance et la perpétuelle remise en jeu de l’Auteure se dissipent dans la banale médiocrité de cette production art et essai mondiale qui encombre les festivals.
(Pierre Audebert, Culturopoing, "Liberté, parité, fraternité : le cinéma féminin au Québec !" 20 juin 2017)



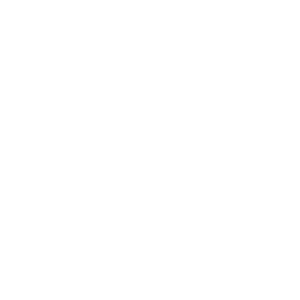
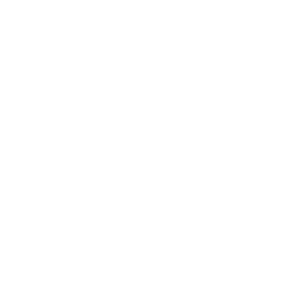
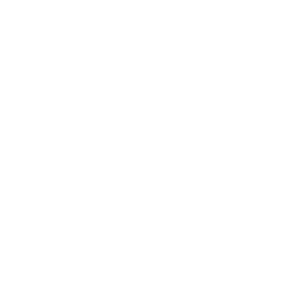
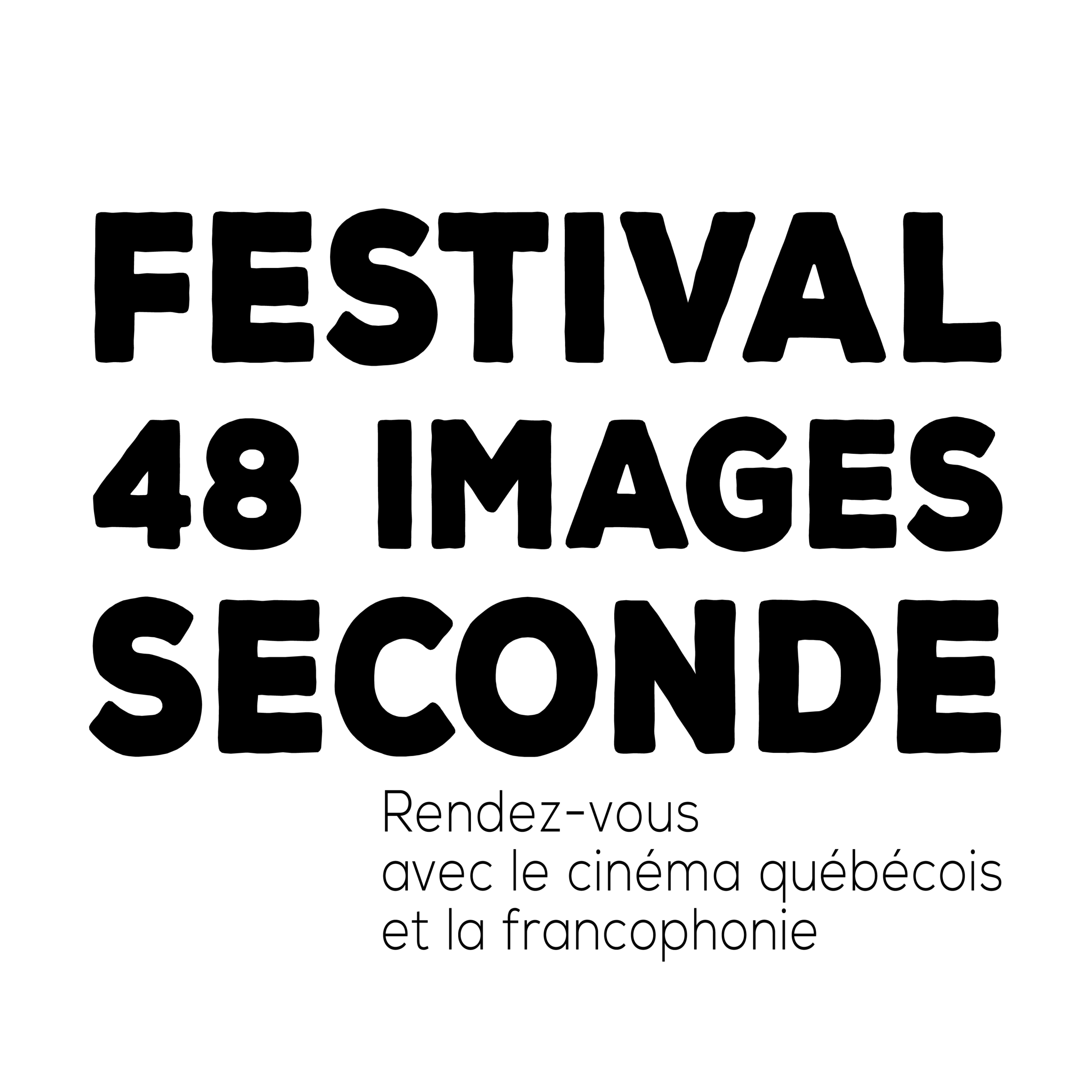


Ajouter votre avis