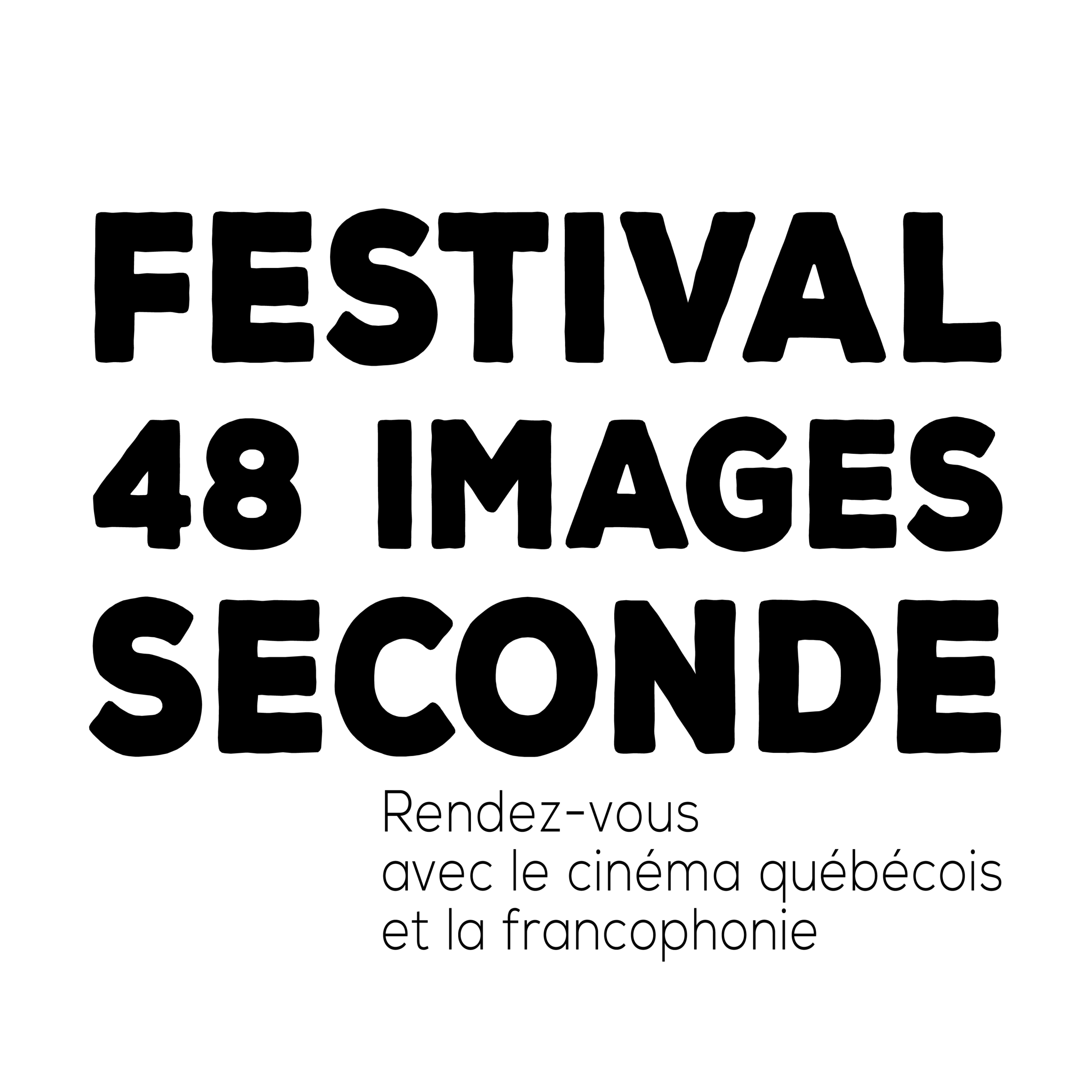- Partagez
- prev
- next
Entrevue de Mon cinéma québécois en France
Ces mots là, que je n’avais jamais dits à haute voix :
Entrevue au festival 48 images seconde de Florac avec Fanny Mallette, comédienne et réalisatrice, par Pierre Audebert
Il ne m'avait pas fallu beaucoup de films pour la remarquer. Fascinante chez Stéphane Lafleur, on l'avait aussi vue déchirée dans le Chorus de François Delisle. En apercevant Fanny Mallette devant La Genette verte de Florac, je me sentais comme tombé de la lune... Déjà ébloui par un regard éclatant, je restais suspendu à son sourire infini. Je peux donc vous le jurer : une nouvelle étoile a traversé la réserve de ciel étoilé du Parc National des Cévennes. Star des petits et grands écrans de l'autre côté de l'Atlantique, elle brillait ici dans l'anonymat de nouvelles constellations, un film d'auteur quasi-expérimental dans son processus de fabrication et un court-métrage réalisé avec amour pour un nouveau départ derrière la caméra. L'écouter tout au long de cette entrevue tient presque de l'expérience mystique. Il y a tellement d'attention et de présence, d'intensité dans les propos, de justesse dans le choix des mots qu'en effet, la moindre station de son parcours d'actrice s'éclairait de nouvelles strates.
Bien que je fusse un peu fébrile dans cet exercice, je relis avec délectation ces confidences qui je l'espère, vous éclaireront toutes et tous, sur le métier de comédienne et l'aventure sans cesse renouvelée des tournages. Ces beaux débuts de réalisatrice nous font attendre le second avec impatience. Aimée, sans aucun doute...
 Fanny Mallette au festival 48 images seconde de Florac
Fanny Mallette au festival 48 images seconde de Florac
La légende a commencé très tôt, la biographie officielle à 17 ans avec la série Scoop (1992). Après avoir vu une belle photo de Jean Blais où vous parodiez Audrey Hepburn, je me demandais quelles étaient les comédiennes qui vous transportaient quand vous étiez enfant ?
Quand j’étais enfant ou adolescente, c’est comme si j’avais grandi avec Charlotte Gainsbourg. À cette époque là, pendant la décennie 80-90, les films français étaient mieux distribués à Montréal et j’ai vraiment tout vu, tout ce qui passait. Ma tante avait aussi un pied à terre à Paris et pas mal de cassettes vidéo chez elle. J’ai vu beaucoup de ces films, dont ceux de Charlotte Gainsbourg. C’est un peu une idole pour moi. J’admire beaucoup son parcours, l’actrice qu’elle est devenue, la chanteuse, la femme aussi. Elle est à peine plus vieille que moi donc suivre son parcours, ça a inspiré le mien. Donc elle me suit depuis que je suis petite. Audrey Hepburn, elle, est arrivée vers la fin de l’adolescence. Là aussi, j’ai tout vu et revu. D’autres actrices m’interpellent beaucoup, je pense à Maggie Smith dont je suis le travail. J’aime sa liberté et ce qu’elle va chercher dans le jeu, comme si elle n’avait ni pudeur ni barrières. Elle plonge ! Je trouve ça très beau et inspirant.
Vous avez parfait votre formation à l’école nationale de Théâtre. Quel est votre rapport à la scène et êtes vous remontée depuis sur scène, au théâtre ou dans d’autres formes de spectacle, la chanson ?
La chanson, pas tellement… Un peu. C’est vraiment des accidents de parcours (rire). J’ai entre autres chanté sur un disque de Gilles Vigneault, mais je ne suis pas très forte. J’ai un tout petit filet de voix. Je peux m’en servir mais je ne ferai pas carrière avec ça. La scène, j’en ai fait en sortant de l’école pendant quelques années et puis j’ai décidé de mettre ça de côté pour me consacrer au cinéma. Je préfère… Sur un plateau de tournage, je suis comme à la maison, plus que sur une scène en fait.
Vous êtes ensuite revenue à la série télévisée. Au Québec, la frontière entre le cinéma et la télévision est beaucoup plus poreuse. Ainsi dans la série Tag créée en 2000 par Joanne Arseneau et Luc Dionne et qui mettait en scène des jeunes membres de gangs de rue, - je ne sais pas si les autres jeunes acteurs ont tous pu faire carrière- mais apparaissaient aussi des comédiens de l’envergure de Gabriel Arcand ou Micheline Lanctôt. Dans un extrait où vous faisiez du gringue à un policier (rire) ,vous aviez un piercing dans le nez, la chevelure dreadloxée. Il y a aussi votre voix, un peu cassée, enrouée mais qui laissait passer beaucoup de chaleur et d’humanité. Vous aviez déjà une palette de jeu assez impressionnante !
Merci ! C’est un rôle que j’ai adoré. Au Québec, on appelle ça une « squeegee ». C’était une jeune de la rue, héroïnomane, qui gagnait un peu d’argent en lavant des pare-brises de voitures. Je portais des dreads. Le maquilleur m’avait fait des gales autour de la bouche. J’avais remarqué chez plusieurs toxicomanes des traces de brûlures dues au fait que sous l’effet de la drogue, ils s’endormaient souvent sur leur mégot. J’avais les doigts sales... (rire) Mais j’ai adoré me transformer ! Personnellement, je n’ai jamais pris d’héroïne. Donc j’ai du m’inspirer autant du documentaire et de la fiction que des gens qui travaillent avec les jeunes de la rue. D’ailleurs pour Tag, on tournait aussi avec eux, parce qu’ils venaient faire de la figuration ou des petits rôles. J’ai énormément parlé avec eux et ça a été de belles rencontres car c’étaient des gens extrêmement généreux. Je me sentais un peu comme la petite fille à son papa et à sa maman qui vient jouer la « tuff » ! (rire) Là, je vais parler pour moi qui fait du cinéma d’auteur et pas des blockbusters, c’est à dire que je joue dans des films qui sont dans les deux millions de dollars canadiens, ce qui veut dire des petits tournages de 26 à 30 jours grand maximum… Alors qu’une série télé, même si on a de moins en moins d’argent pour les faire, de type Mensonges (2013-2018) où j’ai joué, ce sont trois mois de tournage, une quarantaine de jours. C’est donc plus lucratif et ça nous aide, parce que si on a la chance de faire un peu de télévision, on peut ensuite choisir ses tournages. J’ai fait aussi beaucoup de tournages bénévolement, parce que c’étaient souvent les plus beaux projets. La télévision m’a permis de les accepter.
 Les muses orphelines (2000)
Les muses orphelines (2000)
D’ailleurs la critique vous remarque la même année dans un film de Robert Favreau, Les muses orphelines et vous obtenez très vite un rôle principal dans Une jeune fille à la fenêtre de Francis Leclerc, puis chez Bernard Emond, tout en continuant de jouer dans des séries télé, notamment avec le rôle de Gastonne Béliveau, la policière de Grande ourse, une série aux colorations fantastiques. C’était un peu le Twin peaks ou le X files québécois ?
X-files c’est vrai, je n’y avais pas pensé. Twin Peaks, beaucoup et je dirais... Fargo ! Moi je jouais la policière un peu naïve, la fille du chef de la police qui est aussi le Maire du village de Grande-Ourse, un village imaginaire. Un type assez corrompu alors que sa fille se met à enquêter. Et elle va devoir vivre avec les conséquences de ses découvertes, parce que sous ses airs naïfs, elle se révèle une excellente enquêtrice. Sinon, c’est avec cette série télé qu’on a commencé à m’appeler par mon nom et non « l’actrice qui joue dans tel truc ». Ce qui était beau aussi, c’est que ça intéressait un public beaucoup plus large que les autres séries dans lesquelles j’avais joué, notamment beaucoup de jeunes de mon âge, mais aussi des plus jeunes ou la génération de mes parents. Après, il y a eu un fan club, comme pour Twin Peaks ! C’était la première fois que je voyais ça. Il y avait même des gens qui appelaient leur chien Gastonne ! (rire) Je trouvais ça drôle, c’est un peu improbable comme nom, personne ne s’appelle comme ça au Québec. Ça, ca a été une expérience vraiment réjouissante !
Vous avez tourné deux fois avec Bernard Émond qui est peu connu en France si ce n’est par le critique Jean-Claude Raspiengeas qui y voit une sorte de janséniste du cinéma, une « solitude » comme on dit au Québec. Quel regard portez vous sur son cinéma et sur ses personnages ?
Bernard se rapproche beaucoup de la réalité. C’est un hyperréaliste. J’ai joué dans son premier film, La femme qui boit (2001). J’y faisais le rôle tenu par Élise Guilbault mais plus jeune. Ça a été une belle rencontre pour moi. Il est très rigoureux, dans la recherche du ton juste. Avant d’attaquer la journée de tournage, il a une vision très précise de ce qu’il veut pour ses scènes. Par la suite, j’ai suivi sa filmographie et bien sûr j’ai des préférences. J’aime qu’il y ait un tout petit peu d’espoir (rire) comme dans La neuvaine. C’est sûr que ce n’est pas nécessairement un cinéma qui te raconte ce que tu veux entendre. Mais l’art doit aussi servir à secouer. C’est un leitmotiv dans le travail de Bernard et même, un but. J’ai l’impression qu’il ne veut surtout pas qu’on sorte de la salle en se disant « C’est un bon petit film ! ». Il veut provoquer à sa façon.
L’année 2003, c’est aussi un rôle de soutien essentiel dans l’univers très masculin du Gaz bar blues de Louis Bélanger, avec tous ces gars qui pissaient dans le lavabo... Il y avait déjà cette force tranquille que vous dégagiez, notamment à travers le soutien indéfectible à votre père joué par Serge Thériault. Vous étiez un peu sa conscience. Et je me souviens aussi du récit magnifique d’une victoire au 400m aux Jeux du Québec. Le père, le sport, la compétition, c’étaient des choses que vous aviez en commun avec Nathalie ?
C’est drôle parce que j’ai participé plusieurs fois aux Jeux du Québec. Je suis championne canadienne en judo. Il paraît que j’ai appris à marcher sur un tatami. C’est mon père qui m’emmenait avec lui dans ses entraînements. Il suivait toutes mes compétitions et j’avoue que c’est pour lui que je voulais gagner, parce qu’en fait je n’ai pas l’âme compétitive… Zéro ! Après avoir décroché la médaille d’or aux championnats canadiens, je suis revenue d’Edmonton en avion et mon père m’attendait. Je lui ai dit que je voulais arrêter le judo et qu’il m’offre un cours de théâtre pour mon anniversaire. Alors j’ai continué le judo mais en arrêtant les compétitions. Cette scène de Gaz bar blues a touché beaucoup de gens. Ils m’en parlent beaucoup. Je pense que c’est parce que c’est lié à la famille. On vient tous d’une famille au départ, qu’elle soit dysfonctionnelle, aimante ou enveloppante. Donc quand au cinéma on nous raconte une histoire familiale, ça fait vibrer quelque chose chez beaucoup de gens, que ce soit positif ou négatif, parce que c’est un sujet universel. Dans cette histoire très personnelle, Louis a réussi à toucher beaucoup de spectateurs dans le monde à travers la famille, mais aussi à travers la disparition de quelque chose. Le thème de la transmission me touche beaucoup. C’est aussi ce que j’essaie d’explorer en tant qu’artiste. C’est un sujet qui m’inspire, qui me questionne, la modernité… J’ai des enfants, donc tout ce à quoi ils ont accès m’interpelle, comme internet… Dans Gaz bar blues, c’était la fin d’un gaz bar avec l’arrivée des self services. C’était probablement le dernier à Montréal mais aussi la fin d’une entreprise familiale. On sent que les fils de cet homme ont d’autres idées, qu’ils vont aller voir ailleurs, apprendre autre chose… La passation, c’est très beau… La fin mais aussi le début de quelque chose de nouveau, une autre génération. Mais c’est aussi un deuil. Toutes les sociétés vivent ça !
 Grande Ourse : la clé des possibles (2008)
Grande Ourse : la clé des possibles (2008)
Ça nous ramène à la thématique de Stealing Alice, mais on y reviendra. Louis disait l’an passait qu’il donnait beaucoup d’informations sur les personnages en amont. Quel souvenir gardez vous du travail avec lui et de sa manière de diriger les acteurs ?
J’ai adoré travailler avec Louis parce qu’il est très présent avec ses acteurs. J’ai aussi rencontré sa sœur qui était là à un moment donné sur le tournage, la vraie Nathalie ! Son frère musicien… J’ai aimé travailler avec lui parce que c’était toujours dans la bonne humeur et dans une direction d’acteurs de proximité. Et puis ça ne faisait pas très longtemps que j’étais sortie de mon école de théâtre… Mes premières expériences en cinéma m’ont beaucoup gâté !
Dans vos allers-retours entre les terrains de jeu des comédiens, vous avez souvent participé au passage d’une œuvre de la scène ou de la télévision au grand écran. C’est par exemple le très réjouissant et inconnu chez nous Dans une galaxie près de chez vous. Une série devient film avec des répliques acerbes, des idées assez étonnantes, comme cette pluie d’électroménager ou le triangle des Bermudes des bas. Seule preuve de mauvais goût : un rôle trop court, celui de Farlouche du peuple des Gonzo et une réplique inattendue « je suis une merde ». Vous osez en effet des choses très différentes !
Ah oui, j’aime beaucoup quand on m’offre des rôles de composition comme ça. C’est plus difficile en vieillissant parce que les gens nous connaissent un peu plus. C’est plus dur de les surprendre dans un autre registre, alors que quand on est jeune et pas connue, on peut endosser plusieurs personnages vraiment très différents et ça passe bien. C’était un tout petit rôle mais qui m’aura permis de rencontrer Claude Desrosiers avec qui j’ai fait ensuite la série télé Feux (2016). Lui aussi, c’est un incroyable directeur d’acteurs. Au Québec, on a de moins en moins d’argent, donc de moins en moins de temps, surtout en télévision. Donc quand on fait deux ou trois prises, c’est fini. Je venais de finir la série Mensonges (2013-2018) et là je rencontre Claude. Pour ma première journée de tournage, on en était à huit prises ! (rire) Là je me dis qu’il me trouve mauvaise, que ça ne fonctionne pas, mais en réalité, c’était toujours comme ça et avec tout le monde. Je ne sais pas où il trouvait le temps ni comment, mais ça se faisait, on arrivait au bout chaque jour. On faisait ce qu’on appelle de la « dentelle » ou du « fine tuning » (réglage fin). Des fois, il y a des petits rôles importants. Pour moi ça ne représentait qu’une journée de tournage mais une journée complètement folle. Ce texte là ne m’est jamais complètement entré dans la tête car à chaque prise on jouait quelque chose de différent. Dans la mise en scène aussi, il nous demandait de faire différemment et le texte sortait tout croche, comme si c’était un langage imaginaire. C’était très ludique et joyeux ! Donc ce petit rôle m’a permis de retravailler avec lui dans un court-métrage, puis pour d’autres collaborations. C’était une belle rencontre pour moi.
A partir de 2007 commence une collaboration précieuse avec un des grands cinéastes québécois actuel, déjà célébré à Florac, Stéphane Lafleur. Un auteur qui excelle à révéler la richesse intérieure des personnages tout en pointant leur décalage avec leur environnement. J'ai lu quelque part « sous-interprétation ». D’abord avec Continental, où Chantal, une jeune femme singulière avait quelques difficultés à communiquer avec le monde mais entretenait un dialogue très créatif avec elle-même sous forme de messages laissés sur son répondeur. Et puis il y a cette scène incroyable du bébé. Comment vous arriviez à gérer cette émotion extrême ? Vous avez des enfants et est-ce que vous avez des psychoses de ce type ?
D’ailleurs, pendant ce tournage, j’avais deux jeunes enfants dont un bébé ! Ceci dit, il faut préciser que je ne l’ai pas échappé pour de vrai ! (rire) On a fait un avant et un après. Sur le tournage, c’était juste rigolo, mais par la suite la scène a beaucoup marqué les gens, les a choqués ! J’ai fait les trois films que Stéphane a réalisé, toujours avec un très grand plaisir. Lui aussi, sa direction d’acteurs est particulière ! Stéphane est musicien et cherche une justesse du ton presque musicale. Par exemple, on a la réplique « le festival de cinéma ». Moi je le dis comme ça mais lui va s’écarter et répéter comme un mantra « Le festival de cinéma, le festival de cinéma, le festival de cinéma » (rire) et il va le faire sur plusieurs tons pour essayer de trouver la bonne tonalité. Ensuite il revient et c’est comme s’il me donnait la note : « Ok, celle-là, c’est un la bémol ». C’est très très précis et tous les gestes sont travaillés, et chaque objet a sa place dans ses cadres. C’est vraiment comme les morceaux d’un casse-tête qui devraient s’emboîter les uns dans les autres, et pour ça il faut vraiment être au bon endroit ! C’est un cinéma particulier que j’aime beaucoup, je suis une de ses plus grande fan ! Depuis que j’ai commencé à réaliser des courts-métrages, c’est lui qui fait le montage, parce qu’il a cette faculté due à son oreille musicale de savoir arrêter une scène au bon moment pour pas que ça tourne à la complaisance ou si vous y êtes drôle, que le punch s’étiole. Il fait ça sur ses propres films mais je l’ai aussi remarqué dans ses montages, même dans ses prémontages, quand il débroussaille les scènes. C’est comme si les scènes étaient montées selon un rythme particulier. C’est sa grande force et je trouve ça très beau.
 Continental, un film sans fusil (2007)
Continental, un film sans fusil (2007)
C’est dit très différemment mais ça nous rapproche de ce qu’André-Line Beauparlant nous disait de son travail l’année dernière, notamment dans cette façon que la conceptrice visuelle avait d’envisager les acteurs comme une matière vivante. On retrouve aussi cette année son montage caractéristique dans La disparition des lucioles. Stéphane Lafleur parvient à sublimer le quotidien dans des instants précieux, comme ce finale d’En terrains connus, où sur votre visage, déjà si familier pour le public québécois, les pleurs se mêlent au rire pour devenir un territoire inconnu. Comment Stéphane Lafleur décrit-il ses personnages dans le scénario de départ et quelle est votre liberté d’action ?
Notre liberté vient de ce qu’on a à offrir en tant que personne. Notre personnalité va remonter à la surface. C’est ce qui me plaît dans mon travail d’actrice, travailler avec des gens très différents et trouver ma liberté dans certaines contraintes. Oui, on a des contraintes avec Stéphane. Mais il y a quelque chose de beau dans ce travail là, d’arriver à donner ma couleur à ce personnage là. Et en effet, à la lecture du scénario, pour ma part, tout est là ! Je comprends le film à l’écriture et ce que je vois à l’écran, c’est ce que j’y ai lu. Bien sûr on a discuté, on s’est rencontrés et on a fait des lectures, mais une fois que j’arrive sur le plateau de tournage, je sais dans quel film je joue. Donc sa façon de diriger n’est en rien une surprise, surtout à partir du deuxième, là j’en savais un peu plus ! Chantal et Maryse sont deux personnages qui peuvent se ressembler, mais il y a toujours cette recherche d’une couleur propre à chaque personnage qui est intéressante à faire, autant pour lui que pour moi.
Je ne peux pas m’empêcher de penser à la capsule hilarante de l’homme du futur sur le bonus dvd de l’édition française, où le garagiste nous montre cette relique qu’il a gardé de vous - et on le comprend, on le jalouse même -, rien moins que votre carburateur ! (rires) Votre public aime comme cela garder des choses liées aux émotions que vous lui faites passer ?
Pour le cinéma de Stéphane, c’est particulier. Il y a deux sortes de publics. Le premier, celui qui voit l’humour de son cinéma et le public qui prend le degré plus triste, parce que ce sont des personnages qui ont des vies ordinaires, qui vivent dans des banlieues grises. Ce sont des films où il ne fait pas souvent soleil ! Ce sont aussi des gens assez seuls… Donc parfois, au sortir des salles, les gens sont parfois un peu déprimés. Par contre, certaines personnes dont je fais partie vont rire tout du long. Je trouve ça si beau cet humour qui se loge dans les petits détails parce que la vie est aussi faite de ça : la tristesse est partout mais l’humour aussi. Comme quand on voit quelqu’un trébucher… On trouve ce paradoxe dans nos gestes quotidiens. Quant à la dimension surnaturelle de ses films, elle est très subtile et crée un décalage avec l’histoire réaliste. Dans Continental, c’est cet homme qui disparaît on ne sait où dans la forêt et que sa femme va retrouver au même endroit à la fin. C’est quelque chose de très intriguant ! Dans En terrains connus, c’est cet homme du futur qui arrive juste de septembre prochain (rire) et dans Tu dors Nicole, ce petit garçon qui parle avec une voix d’homme. C’est comme un petit clin d’œil avec un sourire derrière. La réalité « poche » – ça c’est très québécois ! -, plate, terre à terre, de ces gens là qui travaillent au même endroit tous les jours de leur vie, n’ont pas beaucoup de fréquentations mais trouvent quand même du bonheur dans les petites choses. Pour moi, c’est dans ce décalage que se loge le cinéma !
 En terrains connus (2011)
En terrains connus (2011)
Mais dans le cas de l’homme du futur, il s’agit d’un comédien professionnel ou… ? On finit par douter !
Cet acteur était déjà présent dans Continental un film sans fusil, dans la scène où Réal se voit proposer un « trip à trois ». Le mari de la femme qui l’invite dans sa chambre est Denis Houle. C’est aussi un acteur connu pour une émission pour enfants et qui a ses fans, suffisamment pour avoir ses propres capsules sur internet. Son personnage a sa propre histoire ! C’est vraiment un acteur intéressant.
Je ne sais pas si on peut dire que vous carburez au risque ? Chaque nouveau rôle est en effet un voyage, même si c’est vers le bout de la nuit. Sept jours de talion, une vie de regrets. C’est Sylvie Hamel qui après le drame atroce du meurtre de sa fille doit gérer la culpabilité -ce « je vais tout te faire » qui avait peut-être provoqué un « tout lui faire subir » chez son mari dévasté par le viol et le meurtre de sa fille unique. Podz réussissait là un torture porn un genre très contemporain inégal et avant tout, un film moral. Il est aussi un directeur d'acteur réputé. Marc-André Grondin nous avait confié l’an passé que ça avait sans doute été la rencontre la plus importante qu'il avait eu à l’âge adulte avec un metteur en scène. Comment avez-vous perçu le travail avec Podz et confirmez-vous ce sentiment ?
Oui, vraiment ! J’ai aussi fait une série télé avec lui, 19:2, ce qui m’a fait deux expériences avec lui, deux ambiances, deux rôles très différents aussi. J’avoue que pour moi, Les sept jours du talion a été un film très dur émotionnellement, d’autant que j’étais enceinte. J’avais les hormones dans le tapis ! Je devais parfois retenir les larmes, parfois les laisser sortir donc j’étais à fleur de peau pendant le tournage. Ça c’était ma première expérience avec Podz et une chouette rencontre. J’aime beaucoup sa façon de diriger, ce besoin d’être seul avec les acteurs au début d’une scène. C’est quelque chose qu’on a perdu mais que moi j’avais vécu dans ma jeunesse, quand on avait un peu plus de temps sur les tournages avec les acteurs. Parfois on vidait tout le plateau, juste pour faire une répétition avec les acteurs. Pour Tag, Pierre Houle faisait ça. (elle reprend sur Podz) Quelque fois il se permettait de couper dans les scènes trop longues, il réécrivait à l’instinct, parce que c’est là quand on répète sur le plateau qu’on découvre parfois les faiblesses d’une scène ou trop de complaisance. Il avait beaucoup d’intelligence émotionnelle et il aime vraiment les acteurs. On se sent accompagnée, enveloppée et c’est très sécurisant. Après ça, ça nous laisse beaucoup d’espace pour plonger, parce que c’est un cinéma qui demande d’ouvrir les vannes, d’arriver sur le plateau et de se laisser aller, sans pudeur et sans peur. Il réussit à nous mettre dans une ambiance propice à cette façon de jouer. j’ai adoré travailler avec Podz !
 Les Sept Jours du talion (2010)
Les Sept Jours du talion (2010)
Partager les grandes douleurs de vos concitoyens, c’est votre manière de rendre de l’amour à votre public en permettant au public d’amorcer une résilience face à ce type de faits de société ?
C’est une bonne question parce que je suis abonnée à ces personnages là depuis quelques années. Ça fait trois ou quatre fois que je joue la mère éplorée, endeuillée. Dans Chorus, c’était pareil mais à chaque fois ce sont des situations très différentes et des personnages qui réagissent autrement. Vous parlez de résilience. Dans Chorus c’est ça. Une quête de rédemption aussi. Le parcours était très important pour moi et très différent des Sept jours du talion où là, c’est un événement qui arrive à chaud. Dans Chorus, il date de dix ans. Un chemin avait été fait depuis. Il y a aussi une histoire d’amour autour. C’est comme si comme actrice, je pouvais vivre par procuration certaines peurs et certains désirs. J’ai trois enfants, or j’ai interprété trois personnages qui perdent leur enfant. La boucle est bouclée ! Maintenant, je peux respirer… Je pense que pour le public, il y a là quelque chose de libérateur en allant voir ces films pour y vivre ces choses par procuration, certaines émotions que l’on ne peut pas s’autoriser dans la vie. On connaît tous ces peurs quand on a des enfants, qu’ils leur arrivent les pires atrocités. Mais le cinéma sublime ça, c’est aussi sa fonction. Ce qui est beau avec ces rôles là, c’est que ça donne des films très différents. Je disais trois, mais c’est plutôt quatre en fait (rire). j’oubliais L’amour dans lequel j’ai joué l’an passé. Même si c’était un jeune adulte, c’était quand même une mère en deuil là aussi.
Le rôle d'Irène dans Chorus est un point d'orgue de votre carrière. Vous y interprétez, la fille de Geneviève Bujold, une très belle filiation.
Tantôt vous parliez d’actrices… Geneviève Bujold m’a suivi toute ma jeunesse elle aussi, parce que mes professeurs me comparaient à elle ou alors les parents de mes amis me disaient que je lui ressemblais. Pareil quand j’ai commencé les tournages, avec les directeurs photo. C’est donc un peu grâce à tout ça que j’ai commencé à visionner sa filmographie. À un moment donné, je me suis dit : quelqu’un va bien nous réunir, nous rassembler. Il faut bien que je la rencontre ! Et c’est François Delisle qui l’a fait… Quand j’ai su que j’allais travailler avec elle, je n’ai pas beaucoup dormi...(rire) Comme elle ne vit pas à Montréal, François et moi sommes allés la rencontrer dans sa chambre d’hôtel. Quand nous sommes arrivés, toutes les deux nous avons reculé d’un pas ! (rire) C’est comme si on se voyait. Elle, elle avait ses longs cheveux blancs et sa petite taille d’adolescente. Comme je jouais sa fille et que Geneviève ressentait chaque émotion durant le tournage comme son personnage, elle a spontanément ressenti pour moi de l’affection. En dehors de ça, on s’est beaucoup parlé pendant les journées de tournage, on s’est raconté nos vies et il y avait vraiment une proximité de cœur, d’âme et de façon de travailler. Elle s’est d’ailleurs beaucoup reconnue en moi. Je suis sans doute plus discrète qu’elle ne l’a été durant sa jeunesse (rire). Je sais qu’elle était assez flamboyante. Mais dans notre façon de travailler, dans ce besoin que nous avons nous, actrices, d’être aimées, dans le fait qu’elle aussi a des garçons, on s’est trouvés beaucoup de points communs et par la suite nous avons continué à nous écrire, mais à la main et par la poste comme j’aime le faire. Ça a été une rencontre vraiment déterminante dans mon parcours parce que j’ai beaucoup aimé la regarder travailler. Elle arrive toujours avec des propositions : c’est elle qui avait apporté ses vêtements, qui a construit son personnage et ce jusqu’à sa coiffure. Elle avait une idée très précise de ce qu’elle voulait. Ensemble devant la caméra, ça n’a été que du plaisir, de la découverte… On est très intenses dans le jeu toutes les deux. Je finissais mes journées avec le sentiment d’une espèce de devoir accompli, d’être allée au bout de quelque chose...
 Chorus (2015)
Chorus (2015)
Le film est en effet bouleversant. On ressent bien cette intensité. Sinon j'ai pu visionner un épisode de Mensonges, une série policière où vous interprétez Julie Beauchemin. Je me suis fait cette réflexion que si Carl Theodor Dreyer était en vie, il vous aurait offert bien des rôles. La réalisation de Sylvain Archambault insiste justement sur les très gros plans sur votre visage et il a une manière bien particulière de l’éclairer. Je rejoins André Ducharme et son hommage bien nommé, Fanny ardente, lorsqu'il écrit et ce dès 2004, « Il y a beaucoup de monde sur son visage. » Autrement dit, on a parfois le sentiment que votre visage-paysage éclaire le cinéma, qu'il permet au public de s'y projeter. Vous créez un lien intime avec le public. Est-ce que c'est autant un bonheur qu'une responsabilité ?
Oui, il ne faut pas que je les laisse tomber, surtout en télévision. J’entre dans le salon des gens. Dans le cas de Mensonges, ce qui était particulier c’était l’utilisation permanente de la caméra à l’épaule et en effet, il y a des extrêmes gros plans ! Parfois j’avais vraiment la caméra… (elle rit comme si on la chatouillait) collée sur moi. D’autant que Sylvain a une manière particulière de tourner : on peut faire du champ-contrechamp mais il faut toujours avoir la « switch en on », c’est à dire qu’il faut toujours jouer même quand la caméra est sur l’autre acteur. Si après le mien, on fait un gros plan sur vous, moi je dois quand même tout donner parce que la caméra peut se retourner vers moi n’importe quand. Dans le cas de Mensonges, les salles d’interrogatoires comportaient une vitre sans tain, donc si la caméra était sur vous, Jérôme Sabourin pouvait à tout moment faire le point sur moi pour capter ma réaction. Ça a créé quelque chose d’intéressant dans le jeu, dans le fait de ne pouvoir s’asseoir sur rien parce qu’en plus ils ne coupent pas au moment du changement d’objectif. On passe d’une 50 mm à une 85 mm et il n’y a pas d’interruption. Il donne ses instructions dans le micro et nous avons toujours un petit haut-parleur à proximité. À la fin de la prise au lieu de dire « Coupez ! », il va dire (elle prend une grosse voix) « 85 ! ». Ce qui veut dire qu’on change de plan mais que ça continue à tourner. Et ça ne prend que quatre secondes, je le jure ! On la refait alors en plus serré… Ça a ses bons et mauvais côtés. Au mieux, on reste chauds, à vif, à fleur de peau. Parce qu’on n’a pas le temps d’aller prendre un café et d’oublier ce qu’on vient de vivre. Non, on est toujours là, présents. Mais j’aurais fait la même chose avec plusieurs prises ! On avait une seule prise par valeur de plan. Il va vraiment chercher le premier instinct. C’est quelque chose qui compte dans la réussite de cette série : nous n’avons pas le temps d’intellectualiser les mots. C’est nôtre corps qui parle, nos tripes. Au final, c’est vraiment particulier. Et le fait que ce soit une série policière, qui plus est beaucoup axée sur les interrogatoires et que dans mon cas, Julie en soitt une spécialiste, fait qu’ils venaient chercher mes yeux. Tout passait beaucoup par le regard. Ça s’appelle Mensonges et il est souvent question du détecteur… Il y a un deuxième et un troisième niveau dans ce personnage qui doit parfois jouer la vérité, parfois en inventer une pour obtenir des aveux, mais là elle doit elle-même y croire. Elle est comme une actrice, quand on joue quelque chose qui n’existe pas : si on n’y croit pas, le public n’y croira pas non plus ! Il y avait donc toutes ces couches qui rendaient ça si intéressant. Moi ça me permettait plein de couleurs différentes dans le jeu. Mensonges, c’était comme si on m’avait offert un bonbon. Ça a été très important pour moi.
 Mensonges (2013-2018)
Mensonges (2013-2018)
Ce récit me rappelle une expérience similaire de Marc-André Grondin pour 123 rue des Ormes, où il disait que le tournage en numérique et l’absence de clap rendait l’expérience de tournage très éprouvante physiquement. Est-ce que vous aviez déjà joué ou est-ce que vous pourriez jouer ce type de rôles très physiques ou encore des thrillers à l’américaine comme ont pu le faire par la suite Scarlett Johanson ou Léa Seydoux ?
Cette implication physique, je l’avais plus dans la quatrième saison de Mensonges, parce que tout d’un coup l’enquêtrice changeait de stratégie et troquait l’interrogatoire pour le terrain. Elle faisait de l’infiltration, donc jouait des personnages, ce qui pouvait tout à coup la rendre vulnérable ou la mettre en danger. Donc j’ai du courir dans la forêt et j’ai adoré ça ! Bien sûr, je serais prête à faire ça. Mais ce qui est le plus important pour moi, ça reste le contenu et ce que j’ai à y trouver en tant qu’actrice. Donc j’ai refusé des offres parce qu’avec l’expérience, je sais ce que représente une journée de tournage. Si je suis par terre, en sang, à gémir toute la journée, il faut quand même qu’il y ait quelque chose d’amusant à aller chercher (rire). On m’a proposé ça dernièrement mais le scénario était intéressant pour les autres mais pas pour mon personnage… Au point où j’en suis aujourd’hui, j’ai envie d’endosser des rôles, donc c’est pour ça que comme je le disais, j’ai fait beaucoup de tournages bénévoles ces dernières années, comme Stealing Alice ou des courts-métrages de jeunes réalisateurs. Ou même des web séries parce qu’on y trouve vraiment une parole inspirante, différente. Surtout avec la jeune génération avec laquelle j’ai beaucoup tourné ces dernières années, quand la personne la plus âgée sur le plateau a juste vingt-cinq ans. J’adore ça ! C’est une autre vision du cinéma, décloisonnée. Parce qu’au Québec on a beaucoup de cases : « t’es une actrice, t’es pas une réalisatrice » « Tu es une auteure, tu ne peux pas faire autre chose »… La seule exception c’est Marc Séguin et ce depuis quelques années. C’est un peintre qui est devenu auteur, et maintenant cinéaste. Au Québec, cette nouvelle génération a trouvé sa place et se sent le droit de tout faire. Je trouve ça très beau et même que ça enlève ce poids à ma génération de faire les choses comme on nous les a apprises ou à entrer dans un cadre ou un moule « ça c’est du cinéma, ça c’en n’est pas... » Non, eux partent d’une urgence de dire. C’est comme ce qu’on retrouvait dans le cinéma de la Nouvelle Vague en France. Alors oui, je peux jouer dans un film d’action mais je veux qu’il y ait une prise de parole, un regard personnel sur les œuvres. J’ai vraiment besoin de ça. Bon, en fait j’en ai toujours eu besoin, mais avec l’expérience, c’est ça qui m’anime. J’ai envie d’aimer mon métier longtemps longtemps longtemps et pour ça je dois choisir des projets qui m’interpellent !
On est toujours frappé par votre douceur, qui passe entre autres par le regard, la voix. Mais est-ce que vous avez eu à interpréter des personnages durs ou même déplaisants ?
(avec un plaisir non dissimulé) Oui, j’ai fait ça ! Pour une série magnifique qui s’appelait Nos étés et couvre plusieurs époques. Chaque époque avait le style d’un cinéaste différent. Pour beaucoup, ils venaient du cinéma, comme par exemple Francis Leclerc avec qui j’ai commencé. Je jouais Nora, une femme très rigide, dure, voire même injuste avec ses domestiques. Bref, c’était une bourgeoise ! La première saison se déroulait au début du vingtième siècle et je jouais ce personnage jusqu’à ses 75 ans, donc chaque matin j’avais trois heures de maquillage rien que pour le visage, ça c’était moins amusant ! (rire) Ce qui me plaît dans ces personnages, c’est de trouver la faille : pourquoi elle a cette dureté là qui la rend carrément méchante avec certaines personnes ? La méchanceté, ça n’arrive pas comme ça, mais parce qu’il y a une blessure, c’est ça qui m’intéresse. Mais c’est sûr que la première année, les gens ont eu du plaisir à me détester. Mais j’adorais jouer ça ! (elle s’emballe) Des fois je disais « Oh je suis désolée ! » parce que je n’étais pas très gentille… Mais ce qui était beau dans l’écriture de ce personnage, c’était qu’au fil des années, avec la guerre qui arrivait, elle s’assouplissait un petit peu et réussissait à vivre une vie plus libre, à s’émanciper en tant que femme à une époque où ça n’était pas facile, donc ça l’a humanisé. Bon, elle ne gagnera pas de prix de chaleur ou de gentillesse. C’est un rôle qui quand on me l’a offert - parce qu’à l’âge que j’avais (30 ans), j’auditionnais encore -, m’a vraiment surprise. Quand on m’offre un rôle, c’est comme si on me faisait confiance, donc je vais travailler encore plus fort pour être à la hauteur. Donc ce tournage a représenté pour moi beaucoup de travail pour ne pas avoir l’air sympathique… J’ai fait aussi une autre série qui s’appelait Vertiges (2014) où je jouais une femme qui avait perdu la mémoire après une chute de son balcon. Il y avait un côté thriller puisqu’elle essayait de recomposer l’accident au sortir du coma : était-elle tombée ou essayait-elle de se suicider ? À moins qu’on ne l’ait poussée… Elle enquêtait sur sa propre famille mais elle n’avait plus de canal émotif, même quand elle apprenait que sa propre sœur avait couché avec son amoureux. Le réalisateur Patrice Sauvé m’encourageait à ne pas montrer d’émotions, ce qui est pour moi très difficile. J’avais parfois l’impression d’y arriver mais il venait me voir et me disait « Non ! Il y a trop de choses dans tes yeux ! Elle ne réagit pas parce que pour elle, ça n’est pas connecté à un souvenir puisqu’elle n’en a plus. Elle veut juste savoir ce qu’il s’est passé, c’est tout ! ». Il m’avait dit « T’inquiète pas ! Tu bénéficies d’un capital de sympathie auprès du public, ils vont t’aimer quand même ». Pas facile quand on veut se faire aimer mais Maggie Smith le fait si bien que c’en est un modèle. On peut en faire quelque chose de plus intéressant que la gentille demoiselle...
 Stealing Alice (2015)
Stealing Alice (2015)
Après autant de films et séries, on comprend votre volonté de ne pas vouloir vous enfermer dans quelque chose en particulier. Venons en à ce qui vous amène à Florac cette année, votre collaboration à double sens avec Marc Séguin puisqu’il est réalisateur de Stealing Alice mais aussi producteur de votre court-métrage Le dernier mardi. Quand et comment a eu lieu la rencontre ?
Marc a écrit un livre intitulé Hollywood, qui était son deuxième roman, quand j’étais porte parole du prix des libraires du Québec. À la soirée de remise des prix que j’animais, j’avais à lire des extraits de plusieurs romans sur les cinq romans québécois et les cinq hors Québec sélectionnés. Donc on faisait ces lectures le tout dans une mise en scène théâtralisée et j’ai eu à lire un extrait de Hollywood. Quand Marc m’a vu sur scène, il avait commencé à écrire Nord Alice et il a vu tout d’un coup sortir son personnage, et a ensuite eu l’envie d’écrire un film pour ce personnage. Stealing Alice n’est pas une adaptation de Nord Alice. Ce sont deux œuvres très différentes. La Alice du film n’est pas celle du livre. c’est quand mème une métis, moitié inuit, moitié québécoise. Le père est incarné par Denys Arcand et la mère par Martha Flaherty, petite fille inuit de Robert Flaherty, pionnier du documentaire au Québec. Il y a donc eu cette première rencontre et il m’a contacté quelques mois plus tard pour Stealing Alice. Il n’avait pas de scénario, que quelques scènes à me faire lire. On a ensuite travaillé par petits bouts durant un an et demi, parce que c’est lui qui a financé le film. On était une petite équipe alors que lui il la trouvait déjà grosse et ça l’a impressionné. (rire) Bon on était une petite équipe mais chacun faisait un peu de tout. On tournait trois ou quatre jours d’affilée tous les deux ou trois mois. On a voyagé un peu partout et après un an et demi, tout ça a fait un film. Marc a aussi fait son film au montage… Moi je savais jamais quand je jouais (rire) et où est-ce que ça allait se retrouver dans l’histoire, avant ou après, ce qui m’obligeait à juste jouer la scène telle qu’elle était écrite là. J’aimais beaucoup ça, ne pas se poser de questions sur l’avant ou sur l’après, c’était très intéressant et c’étaient toujours des mots. Des mots que je n’avais jamais dit à haute voix, ces mots là. C’est ce que nous allons présenter ici dimanche !
Il y a cette notion de modernité, cette impression de déracinement et il y a aussi beaucoup d’introspection. Toujours par rapport à l’histoire d’Alice, quel est votre rapport à l'origine indienne du Québec ?
Aïe aïe aïe ! Sincèrement, ce n’est pas un apport facile. Quand j’étais à l’école on nous appris l’histoire des - aujourd’hui on dit Premières nations - mais à l’époque c’était les Amérindiens. Aujourd’hui, ce n’est plus un terme qu’on peut utiliser. Il y a eu un éclatement, comme un besoin de dire, de nommer ce qui s’est passé parce que ce n’est pas dans nos livres d’Histoire. Enfin, ça commence à l’être mais ça ne l’était pas dans les années 80 ou 90. J’apprends beaucoup depuis quelques années, sur tous ces peuples là parce que ce n’est pas qu’un seul peuple. Le film de Marc m’a beaucoup apporté sur le peuple inuit, les déportations, les génocides qu’il y a eu dans certains villages. C’est une histoire extrêmement triste… Martha m’a aussi beaucoup parlé de sa situation. C’est une grande désolation. Alors si maintenant on peut leur donner la place qui leur revient, que ces peuples là puissent avoir des représentants artistiques, surtout pour la jeune génération. Des gens qui peuvent se dire : « C’est possible, je peux exister. Je peux prendre la parole, faire de la musique, du cinéma, jouer au théâtre… Il y a de plus en plus d’ouverture dans ce sens là. Mais on a été vraiment très loin de ce peuple là pendant très longtemps, c’est vraiment un désastre… Il est temps qu’on se reprenne.
 Stealing Alice (2015)
Stealing Alice (2015)
Votre film Le dernier mardi est tellement cinématographique qu'on a du mal à s'imaginer l'écriture de Marc Séguin. Mais j'imagine que ses mots génèrent beaucoup d'images…
Oui , c’est une très belle nouvelle. Il l’a écrite à ma demande parce que ces mots de Stealing Alice, je ne les avais jamais dits. Je ne parle pas d’un mot en particulier mais de l’ensemble des mots, d’un ordre. Sa façon d’écrire est très particulière et moi j’aimais beaucoup dire ces mots là. Donc j’ai eu envie de continuer à travailler avec ces mots mais d’une façon différente. J’avais déjà écrit par le passé mais comme j’avais vraiment envie de passer à la réalisation, je me suis dit qu’il fallait peut-être commencer par les mots de quelqu’un d’autre. Je lui ai demandé s’il n’avait pas une nouvelle à me faire lire. Il a écrit pour moi cette nouvelle que j’ai adaptée pour le cinéma. Il faut préciser que ce film s’est fait sans argent et que c’est Marc qui l’a financé et les gens sont venus bénévolement. Je l’ai tourné dans l’appartement de ma mère, ce qui a nécessité une adaptation. J’aurais pu flyer (m’échapper) un peu plus et ouvrir le huis-clos mais ça reste dans l’appartement de Marie-Ange. En fait, j’ai vraiment eu envie d’aller à l’essentiel avec ce texte, de trouver l’essence de ce que ces mots portent. J’ai toujours été attirée par la vieillesse, autant en photographie qu’au cinéma et dans la vie. J’aime beaucoup parler avec des personnes âgées et aussi parce que j’ai beaucoup à apprendre d’elles. Je trouve qu’on ne les représente pas beaucoup à l’écran. J’ai demandé à Françoise Faucher qui est une actrice grandiose et une femme merveilleuse, de venir jouer le rôle de Marie-Ange et je voulais être claire dès le départ que je n’allais pas masquer son âge et qu’elle était trop jeune pour le personnage. Elle avait déjà 86 ans à l’époque. J’avais envie de voir une vieille femme à l’écran et de montrer cette beauté là.
Il y a de nombreux allers retours entre la mise en image et le dialogue : les compresses sur les yeux qui nous confirment que l'amour est aveugle... Le dialogue off crée un effet de répétition du même.
C’est exactement ça. Le film s’appelle Le dernier mardi. Je voulais donc poser le fait que l’infirmière Éléonore, venait voir Marie-Ange tous les mardis. Ce sont deux femmes assez discrètes et qui ont réussi à se créer une petite intimité, encore très fragile. Mais si j’ai mis les dialogues en voix-off, c’est parce qu’on ne sait pas si c’est ce mardi là, celui de la semaine dernière ou un autre. C’est dans mon esprit un rendez-vous hebdomadaire qui dure depuis un mois mais peut-être depuis un an et demi ou deux ans. Je voulais qu’on voit le temps qui passe, la vie qui est répétitive pour Marie-Ange… parce qu’elle ne sort plus, qu’elle est presque aveugle et qu’elle ne peut plus se déplacer. Et qu’elle va mourir ce mardi là mais que ça aurait pu être celui d’avant. Pour Marie-Ange, ça ne faisait plus vraiment de différence...
 Le dernier mardi (2018)
Le dernier mardi (2018)
Il y a aussi ce contraste entre les deux femmes, même si leur lien crée un rituel commun. D’un côté la délicatesse et la fragilité, de l’autre quelque chose, pas de dur et de cruel mais de jeune et d’extrêmement vivant,- il s’agit d’ailleurs d’une jeune comédienne - Emmanuelle Lussier-Martinez - que nous avions découverte fragile dans Les mauvaises herbes de Louis Bélanger - avec au début un soupçon de brutalité entre elles.
Il y a quelque chose que j’aime bien dans ce personnage parce que c’est une infirmière à domicile et qu’elles ont cette bonté naturelle. Mais Éléonore vit une peine d’amour. Ce n’est pas nommé mais suggéré. Elle voit bien que Marie-Ange a besoin de ses soins et qu’une aide soignante ne peut pas quitter le domicile d’une vieille dame qui va mourir, ça ne se peut pas ! Mais dans mon histoire, c’est une jeune femme qui est aussi très égocentrique, prise dans ses tourments à elle. La vie de Marie-Ange fait écho à ses propres questionnements amoureux. c’est pour cela que j’ai voulu mettre en mouvement la photo de Marie-Ange et de son mari quand ils sont jeunes et qu’Éléonore les regarde. Au départ la photo est assez sérieuse, le couple pose sans sourire mais Éléonore voudrait que Marie-Ange ait eu une belle histoire d’amour parce qu’elle aimerait aussi en vivre une. Donc elle imagine le couple… Ce jour là, il y a eu du vent. Ça fait bouger les cheveux de la jeune Marie-Ange, la cravate de son mari, ça les fait rigoler, ils se sont rapprochés et il l’a embrassée. Éléonore se projette un peu dans cette histoire là. En fait, mon explication est plus longue que la scène elle-même ! Elle va poser des questions à Marie-Ange sur sa vie mais c’est pour chercher des réponses à ses propres questions amoureuses.
Dans Stealing Alice, on dit que l'amour est comme la toundra et que la distance devient l'autre mais on ne le sent pas ici entre elles… (elle hoche la tête) Avez-vous écrit ou réalisé d’autres courts métrages et sont-ils en rapport avec ces deux derniers films ?
Je viens d’en terminer un second qui est prêt à être diffusé. Cette fois-ci, je l’ai écrit moi-même. C’est une histoire très personnelle, celle de trois sœurs qui se retrouvent dans l’appartement de leur père décédé pour le vider. C’est très différent de l’univers du Dernier mardi et ça n’entraîne pas la même signature. Il est plus proche de ce que je suis et aussi de ce que j’aime voir au cinéma. Peut-être qu’un jour il arrivera jusqu’à Florac parce que là, il est tout chaud et vient d’être envoyé dans les festivals. Je l’aime beaucoup et j’espère qu’il me fera voyager. Il s’appelle Aimé...