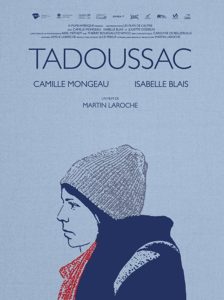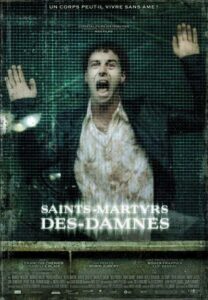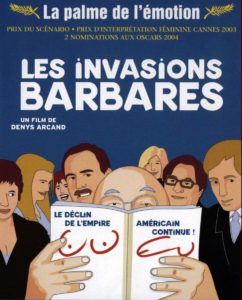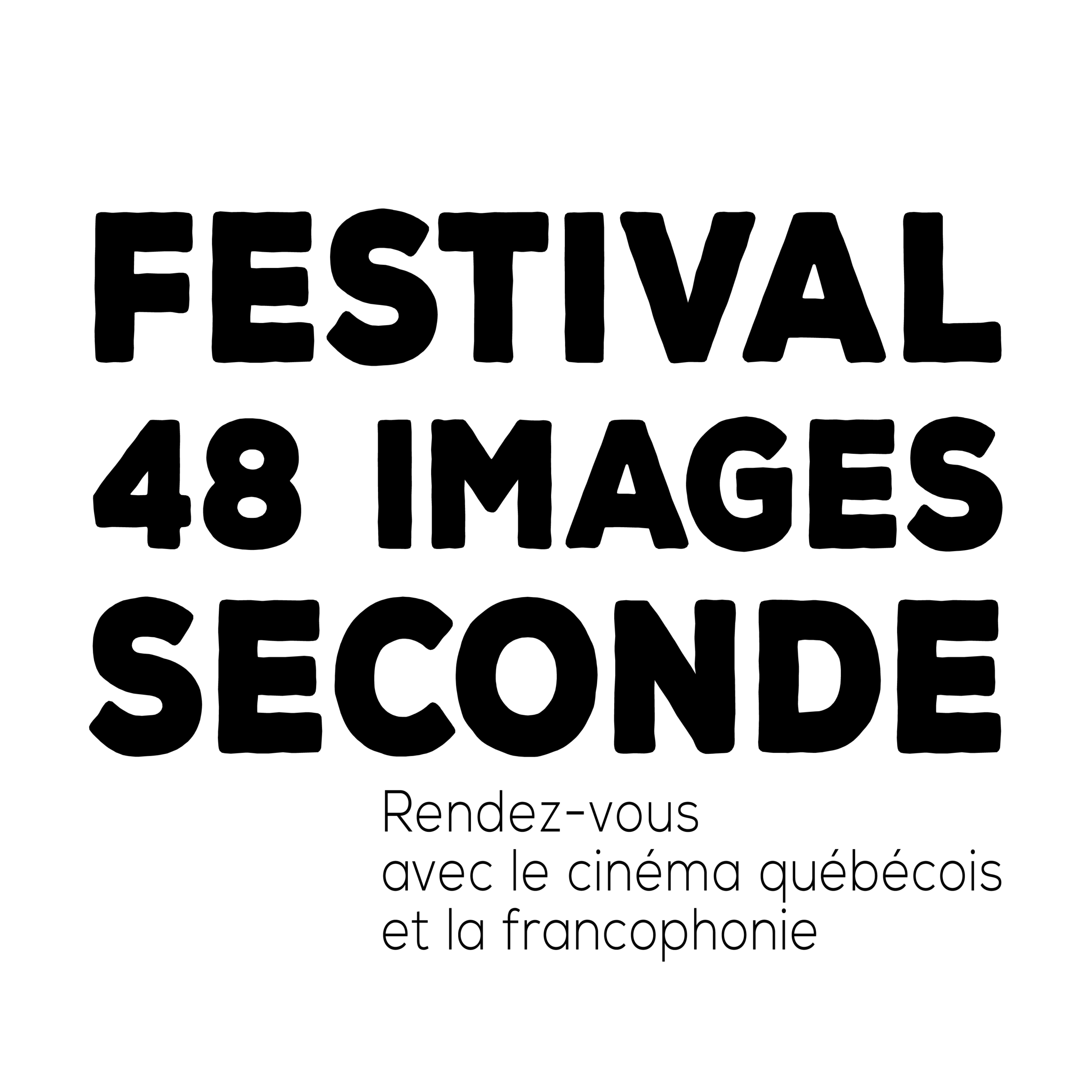- Partagez
- prev
- next
Entrevue de Mon cinéma québécois en France
Derrière l’œil de la comédienne : une rencontre courte et intense avec Isabelle Blais
Entretien avec Pierre Audebert au festival Vues du Québec de Florac en avril 2023
Depuis le temps que j'avais craqué sur ses personnages, sur ce visage-paysage, ce rayonnement, j'avoue que j'étais un peu impressionné de rencontrer enfin Isabelle Blais. Et puis son partenaire à la scène et à l'écran Pierre-Luc Brillant m'avait parlé de leur rencontre et de certains titres de leur filmographie. Entre-temps, il y avait eu la découvert de Borderline, un film où elle se mettait en danger et qui venait dégeler une image du cinéma québécois qui commençait à se figer. Bref, son parcours posait question car finalement cette grande figure de la cinématographie québécoise affectionne les grands rôles des premiers films et les apparitions furtives chez les célébrités. Il y a pourtant une belle cohérence dans tout cela et elle nous l'explique avec une grande franchise vu qu'entre l'amour de la scène et celui des beaux personnages, le plaisir des rencontres et des cinéastes de talent, elle a bâti une carrière remarquable et à son image. Entre dentelle et intensité.
Ta formation vient du Conservatoire d’art dramatique...
Oui celui de Montréal car il y a aussi celui de Québec.
Qu’en as-tu retenu ?
Je suis très heureuse d’être passée par là. Je sais qu’il y a plusieurs chemins pour arriver à faire ce métier. Certains ne font pas d’école, peu importe… Pour moi, ça a été très formateur. En fait, tu apprends à te connaître, c’est un truc presque psychanalytique. La première année, c’est de l’exploration : regarder un peu comment on est, au plan émotionnel… Les premières années ont donc été une sorte de quête de soi. Après on voit aussi toute la technique, la voix, le personnage… mais c’est vraiment une rencontre avec les autres. C’est comme une bulle avec 9 personnes. c’est tout juste si on n’y dort pas !
Pendant trois ans...
C’est donc intense. Et puis on se voit dans tous nos états puisque les exercices nous emmènent loin dans l’émotion. On se met à nu devant nos camarades. Mais j’ai adoré cette période. Sans ça, je ne sais pas si j’aurais été assez outillée. J’y ai eu de très bons professeurs, des amitiés aussi. c’est aussi qu’à l’école tu vas travailler des choses que peut-être tu ne retravailleras plus jamais de ta vie. On peut se le permettre dans ce contexte car c’est pour le but de l’exercice. Par exemple, on avait travaillé du Dostoïevski et j’avais fait l’inspecteur, un homme obèse. Je pense que plus jamais je ne jouerai ça mais c’est très formateur !
Pour toi, le cinéma est arrivé après le théâtre, puis la télévision et le chant puisque tu étais déjà dans un groupe...
Oui, au CEGEP.
Comment vois-tu ton évolution dans dans ces domaines respectifs et comment établis-tu aujourd’hui tes priorités ?
Oh, je dirais que ne décide pas de grand-chose… (rire) La musique, c’est un peu un hasard. Ça m’intéressait au beaucoup au lycée. Aujourd’hui c’est mixte mais à l’époque moi j’allais à l’école des filles et puis il y avait une école de garçons avec une réunion de fin d’année pour monter une comédie musicale dans une très grande salle à Trois Rivières, la salle J. Antonio Thompson, 1100 places. On jouait 9 représentations. Donc on préparait ça et pour moi mon objectif d’y participer était clair. Le théâtre… J’ai aussi fait beaucoup d’improvisation durant tout mon secondaire. Je savais que j’aimais ça et que je voulais en faire. De là à en faire un métier, il y avait de la marge, mais tu continues… Puis la musique c’est arrivé après au CEGEP, durant ces deux années à se pogner le beigne (ne rien foutre). (rire) Tu peux faire des formations générales où tu cherches ce que tu veux faire, quelle spécialité tu prendras à l’Université. Tu peux aussi en faire une plus technique de trois ans, c’est plus spécialisé. Sinon durant deux ans c’est plutôt général à l’exception d’une option : Arts et Lettres… Quand tu sais déjà ce que tu veux faire, c’est un passage un peu flou, bon c’est bien de faire de la philo et tout ça… mais c’est là que j’ai rencontré Nicolas Grimard avec qui je fais de la musique encore aujourd’hui dans Comme dans un film. Il faisait de la musique depuis longtemps avec un groupe et ils m’avaient invité à leur local de musique. j’ai commencé à improviser. Je n’avais jamais écrit mais je me suis dit que j’allais peut-être me mettre à écrire. En rentrant au Conservatoire, je suis partie pour Montréal. Je ne les ai pas contactés pendant ces trois ans mais en sortant de l’école, ils avaient tous déménagé à Montréal entre-temps, alors on s’est tous retrouvés et c’est vraiment reparti. J’ai d’abord eu Caïman Fu pendant 12 ans je crois. On a fait quatre albums, beaucoup de concerts, même en France. Ça restait un peu underground mais on a pas mal roulé. Pour moi, ça s’imbrique. Tu sors du Conservatoire mais tu ne travailles pas nécessairement. Quel travail vas-tu trouver ? Pas grand-chose. Alors tu te laisses un peu porter en espérant obtenir des auditions.
Mais aujourd’hui, tu ne choisis pas entre les tournages et les tournées avec Comme dans un film ?
Plus maintenant, c’est sûr. Mais c’est par vagues : il y a des moments où tu as beaucoup d’opportunités. Moi j’ai souvent refusé d’aller à des auditions sachant que je n’aurai pas le temps, si j’avais du théâtre ou un autre truc. Je sais bien qu’au Québec on fait beaucoup de choses en même temps car pour gagner sa vie, il faut vraiment se diversifier, toucher un peu à tout. Des gens qui ne font qu’une chose, c’est très rare. Tout le monde en est là. C’était donc bien d’avoir plusieurs cordes à son arc mais je n’ai jamais été celle qui accepte tout parce qu’elle n’est pas capable de dire non. Je préfère faire bien une chose, m’y consacrer. Je ne dirais pas que je suis lente mais j’aime prendre mon temps. Il faut savoir faire des choix et je les ai rarement regrettés « ça c’est un beau projet, ça aurait été bien de le faire » mais je n’avais pas vraiment le temps. D’autres fois, c’est parce que ça ne me parle pas, que je ne me vois pas faire ce genre de personnage. Ça ne me touche pas aussi je me dis que quelqu’un d’autre serait vraiment mieux que moi. Je suis capable de me dire qu’une autre actrice serait vraiment formidable parce qu’elle voudrait tellement le faire. J’écoute beaucoup cette voix là car je ne veux pas desservir le projet avec un manque d’implication. Ça m’a sans doute amené à faire parfois moins de choses. J’ai eu des cadeaux : j’ai fait une série deux ans de suite mais ça m’était offert…
 Comme dans un film en concert à la Genette verte de Florac, pour le festival Vues du Québec en avril 2023. Photo : Christian Ayesten
Comme dans un film en concert à la Genette verte de Florac, pour le festival Vues du Québec en avril 2023. Photo : Christian Ayesten
La série policière ?
Ça non, j’ai auditionné pour celle-là. Ça s’appelle Les bracelets rouges, c’est une série chorale avec beaucoup de personnages. C’était un beau personnage à défendre. « Veux-tu le faire ? » J’ai trouvé ça touchant « Oui, pourquoi pas ? ». mais ça n’arrive pas tant que ça, c’est par moments. Il y a beaucoup de jeunes et les castings sont aussi l’occasion de se rencontrer s’ils ne te connaissent pas, alors que nous les acteurs, on n’aime pas trop ça...
Tu deviens vite populaire, par exemple en interprétant Sophie Véronneau, la petite amie du grand frère de Deux frères (1999), la série réalisée par Louis Choquette. Tu y apparais comme le phantasme absolu de la jeune fille bien sous tous rapports, avec la bombe sur la tête et à dos de cheval…
Ça c’est la toute première… J’ai d’ailleurs une belle anecdote. C’est un personnage secondaire par rapport aux deux frères… Donc moi j’avais fait du théâtre mais pas encore de télévision. C’était ma toute première journée de tournage, il était sept heures du matin. On m’avait donné quelques leçons pour monter à cheval. Il y avait une scène où on faisait une course au grand galop. Le plan étant assez lointain, ils me proposent de prendre une doublure pour le plan d’ensemble. Évidemment, au plan rapproché ce sera moi. Et moi je me dis que j’aimerais mieux le faire au moins une fois avant de passer au gros plan, histoire de me mettre un peu dedans. « Non non, je vais le faire » je me sentais quand même assez à l’aise mais là c’était une selle à l’anglaise, sans pommeau, je ne pouvais me tenir nulle part. On part et les chevaux qui se sentent talonnés, toujours accélèrent. J’étais derrière, je le dépasse et là c’est plus que le grand galop, ça va vraiment très vite. Et moi je joue mon rôle, je ne sais pas à quoi je pensais, si, je ne pensais pas ! Je me retourne comme prévu pour le narguer « haha, je t’ai dépassé ! ». Mais là il y a une clôture qui arrivait et le cheval a freiné d’un coup sec, je suis passée par dessus encore accrochée à la crinière. Je ne suis pas ce qui s’est passé mais il m’a piaffé dans le dos mais quasiment comme une caresse car les chevaux font quand même attention à leur cavalier mais j’aurais pu y passer. Je suis tombée et j’avais tout un côté du visage en sang et le dos complètement mauve mais mon réflexe a été de me relever « ça va, je vais bien ! ». et toute l’équipe qui était restée figée se met à courir vers moi… Voilà ça c’était ma première scène, ça commençait très fort ! (rires) Finalement, je n’ai rien eu et j’ai continué à tourner car je me sentais tellement mal à l’aise. Je voulais tant bien faire. Mais je n’avais pas de commotion, rien. On remarque simplement dans quelques scènes chez moi avec les chevaux qu’on ne voit que le côté droit de mon visage. La caméra était toujours placée à ma droite car de l’autre côté c’était trop enflé. Voilà pour l’anecdote !
Tes début au cinéma sont liés au cinéma d’auteur, avec Les fantômes des trois madeleines (Guylaine Dionne, 2000), sélectionné à Cannes à la Quinzaine mais aussi André Turpin et Un crabe dans la tête (2001). Là tu es Marie une critique de cinéma au fort caractère. Déjà la caméra d’André Turpin n’arrête pas de recadrer ton visage. Tu es une actrice dont on aime filmer le visage…
J’imagine que cela doit d’abord servir le propos. Peut-être aussi que c’est plus intéressant d’aller voir ce qui se passe dans les non-dits, de presque aller regarder derrière l’œil du comédien. On m’a souvent dit qu’il s’y passait beaucoup de choses. Souvent ce que je vais faire c’est petit, en tout cas j’ai tendance à faire plus petit que plus gros dans le jeu, ce qui oblige peut-être la caméra à s’approcher pour capter ça. Je ne suis pas très exubérante. Après, avec le temps on change, on essaie d’améliorer les choses. Mais dans le jeu, c’est ça que j’aime, ces petits détails et petites choses très subtiles. Je réalise que j’ai fait beaucoup de premiers longs métrages, avec par conséquent des collaborations et un travail qui se font plus par la discussion, des propositions. Il y a un réalisateur qui lui aussi cherche, donc de belles expériences. Un crabe dans la tête appartient à cette mouvance de jeunes réalisateurs puis Québec Montréal (2002) ensuite et ils ont eu un impact à ce moment là. Ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu une série de jeunes réalisateurs.
Tu enchaînes avec un film qui n’a pas grand-chose à voir, Moïse : l'Affaire Roch Thériault (Mario Azzopardi, 2002). Tu y es donc une des concubines de Roch Thériault, le Charles Manson québécois, un personnage faible, sous influence face à Luc Picard.
Mutilée...
Avais-tu rencontré les véritables protagonistes de ce fait divers ?
Oui je représentais une femme qui a vraiment existé et s’est faite mutiler comme ça. Maintenant, elle a un crochet car elle n’a pas voulu se faire faire une main. J’étais très nerveuse à l’idée de la rencontrer. j’avais lu son livre mais je ne pouvais pas y croire. Je me demandais « Mais quelle genre de personne se faite embarquer là dedans, dans un truc comme ça ? » Des idéalistes le plus souvent. Elle n’était pas du tout naïve, au contraire elle avait de l’éducation. Elle était partie dans un genre de quête d’absolu. Cette rencontre m’avait vraiment troublée. Elle avait donc ce crochet et aussi une petite fleur. Elle disait : « je vais toujours m’en rappeler, je veux m’en souvenir ». Voilà sa démarche. Après, moi je ne lui ressemble même pas physiquement donc la question était plus de comprendre. Je ne portais même pas son nom mais ce qui m’arrivait, elle l’avait vraiment vécu. C’était intense quand même… (rire)
 Moïse : l'affaire Roch Thériault (Mario Azzopardi, 2002 ) Capture d'écran.
Moïse : l'affaire Roch Thériault (Mario Azzopardi, 2002 ) Capture d'écran.
Dans un autre genre, peut-être tout aussi intense, quel souvenir gardes-tu du tournage avec Ricardo Trogi de Québec-Montréal, un film surtout basé sur les dialogues et qui se déroule en grande partie dans une voiture?
Oui on était confinés dans un lieu. Je crois (elle réfléchit) que je ne sors jamais de la voiture, j’arrive au début et c’est tout. C’était une belle rencontre. Je n’ai vraiment rencontré personne d’autre puisqu’on jouait à huis-clos dans notre bulle. Avec François Létourneau, on ne se connaissait pas mais c’est surtout avec lui que j’ai travaillé.car même Ricardo, il ne pouvait pas être avec nous dans la voiture, il se tenait aussi à distance et ça c’est particulier. Ensuite pour avoir une bonne qualité de son, on ne pouvait pas mettre la clim. Il fallait aussi fermer les fenêtres et il faisait tellement chaud là dedans. Une chaleur de malade… Et dès qu’on avait fini la scène, on explosait. On transpirait. Je me souviens que j’avais en plus une perruque beaucoup trop grande, équipée à l’arrière et qui bougeait parfois. Des fois je le vois. Je pense que c’était dû au budget un peu restreint, tout était à la bonne franquette mais ça a eu un beau rayonnement…
Tu as obtenu un prix Génie.
Oui. (détachée) Un Jutra aussi, même si on peut plus le dire...
Comment atterris-tu sur le premier film en anglais de George Clooney, réalisateur, Confessions d’un homme dangereux (2002) ? A cause du tournage à Montréal ?
Oui c’est ça. Mais c’est si petit...
Tu y exploites comme rarement ailleurs ton talent pour le burlesque avec une apparition très cartoonesque…
Là je ne fais presque rien.
Tu embrasses quand même le personnage principal ou le contraire, et toi tu fais l’effarouchée…
En fait il ne m’embrasse pas… Je me souviens qu’il y avait des auditions et je me suis dit pourquoi pas ? Même si c’était de très petits rôles. Finalement, j’ai décroché le rôle, qui a nécessité 45 minutes à une heure de tournage pour huit heures d’attente. Mais c’était super chouette de rencontrer quelqu’un plus grand que nature, c’était très impressionnant. Ceci dit, Clooney était très gentil et très sympathique, très simple. C’est ma proposition qui a été retenue. Le personnage de Sam Rockwell devait faire comme s’il me montrait son pénis. Outrée, j’étais sensée lui mettre une gifle. Là je dis à « mon pote Georges » (rire), « Pourrais-je avoir une autre réaction que celle-là ? » Il me dit « C’est vrai que là il en reçoit beaucoup, ce n’est pas très original » « Je peux peut-être juste me mettre à pleurer, toujours outrée ». Il s’est mis à rire et m’a dit « Oh ça c’est vraiment drôle, OK on va faire ça ! » Ça ne m’aurait posé aucun problème de le gifler mais je trouvais que ça c’était plus sympa à jouer ce côté « traumatisée ». En tout cas, c’était une chouette expérience. Court, bref mais... (rires)
Par la suite tu vas interpréter Sylvana dans Monica la mitraille (Pierre Houle, 2004) où tu chantes une très belle version de La vie en rose. Finalement le glamour d’époque te va très bien… Tu chantes même en anglais.
Love me tender…
Ça te va bien le glamour et le cinéma d’époque.
Comme acteur, c’est le fun parce que tu te déguises un peu, c’est une transformation. Et puis c’est un beau personnage, c’est un peu la naïveté, la pureté, le rêve de devenir une chanteuse qui tout à coup se réalise. C’est sûr que c’est un personnage secondaire mais à chaque fois qu’on la voit, elle s’enfonce jusqu’à la mort ou presque, une vraie descente aux enfers. Ce qui est plaisant parce que d’habitude ces personnages là n’ont qu’une fonction alors que là, elle a quand même tout un cheminement. C’est un beau projet, j’ai adoré faire ça.
Elle a aussi pour fonction de mettre en avant la trajectoire contraire de l’héroïne, sa révolte…
C’est ça, alors que Sylvana est avec un conjoint violent et tombe dans la drogue. Mais c’est un beau personnage.
 Trafic d'innocence (Christian Duguay, 2005) Capture d'écran
Trafic d'innocence (Christian Duguay, 2005) Capture d'écran
Tu alternes toujours avec le théâtre et la télévision, les séries populaires comme Nos étés (2005) ou des téléfilms. Qu’est-ce qui te pousse vers des projets comme le rôle de la serveuse tchèque enlevée dans Trafic d’innocence (Christian Duguay, 2005)?
Trafic humain au Québec. Ça c’était très intense. D’abord, c’était tourné en anglais, mais il fallait parler avec un accent tchèque ou disons européen de l’Est. Étonnamment, c’était plus facile pour moi que de ne pas avoir d’accent du tout. Ça m’est plus difficile de passer pour une américaine. On est allés tourner deux semaines à Prague. En plus, on se rend compte que tout ça est encore tellement d’actualité. Mais ce monde interlope rendait tout très intense. On avait des discussions par rapport au sujet et c’était intéressant d’avoir cette réflexion là. La prostitution rapporte quand même beaucoup plus que la drogue et les armes réunies. Encore un personnage intense mais moi j’adore ça quand c’est différent...
Le sujet, le casting comme le parcours de son réalisateur sont beaucoup plus internationaux. Avais-tu envie à cette époque de travailler dans d’autres pays, aux États-Unis ?
J’y serais allée pour un projet. J’ai eu une agente à New York et j’ai fait des auditions, mais elle me disait que pour en avoir beaucoup, il faut s’installer là-bas et moi je n’y étais pas prête. Je n’avais pas envie de me déraciner. Je voulais travailler en français. Pour moi, le Québec c’était chez moi. Mais il y a eu des projets par ci par là. Je suis allée tourner deux mois en Australie pour un téléfilm qui s’appelait Answered by fire (À feu et à sang, 2006), sur le génocide au Timor Oriental. Je faisais une casque bleue. C’était incroyable, merveilleux, j’habitais là bas durant deux mois et demi. On tournait dans la jungle pour faire croire qu’on était au Timor. Wow, il y avait une intensité dans l’équipe… Parce qu’aussi il y avait un aspect historique et politique, ça s’était vraiment produit. Pour moi, ça a été très formateur. Je pouvais parler en anglais mais là j’étais une québécoise montréalaise, je pouvais avoir un petit accent. C’était un projet super intéressant, très différent encore une fois. Un casque bleu, c’est quand même un autre type de personne.
Et un autre type de préparation…
Oui ! Tu te rends compte aussi qu’ils viennent de plein de pays, tout le monde a des accents. Donc il y a eu des projets comme celui-ci mais je n’ai pas voulu aller m’installer aux États-Unis. À un moment j’ai fait trois jours d’auditions. Faire le voyage juste pour ça… Maintenant, tu peux envoyer une self tape, une audition à domicile, ça j’en ai fait quelques unes. Mais à Los Angeles, tu peux vraiment faire jusqu’à onze auditions par semaine si tu as un bon agent car il y a beaucoup d’opportunités. Mais il faut y être… Mais j’ai toujours travaillé, fait du théâtre, de la musique, de la télé. Certes, j’aimerais faire plus de cinéma ou de théâtre mais toujours bien gagné ma vie et fait des bons projets quand même, j’ai été choyée donc je n’vais pas vraiment envie d’aller recommencer à zéro ailleurs.
Apparemment, même quand tu fais des petits trôles tu es en effet assez choyée, par exemple dans les Invasions barbares (Denys Arcand, 2003) et deux apparitions dont la première ou Sylvaine la fille du personnage interprété par Rémi Girard.
Mais les gens m’en ont parlé pendant dix ans !
Il faut dire que tu embrasses littéralement la caméra donc le spectateur…
C’est de l’émotion pure. Mais les gens m’en reparlaient encore et encore alors que j’avais fait d’autres films que je trouvais plus… conséquents ! (rire) Il y a eu des beaux projets, notamment C.A. (2006-2009) pour la télévision que tu n’as pas du voir. Quatre ans !
J’ai vu des épisodes mais je ne t’ai pas trouvée dans la distribution.
J’étais à peu près dans tous les épisodes.
Ce n’est pas la série où tu joues une directrice d’hôpital ?
Non, c’est sur des trentenaires qui parlent de sexualité, de leurs histoires de sexe. C’était un beau projet. Je sais bien qu’en France il y a plus de séparations entre télévision et cinéma mais chez nous le plus souvent les cinéastes font de la télévision car ils n’ont pas assez de projets. Le niveau de la télévision y est aussi plus développé.
 Saints-Martyrs-des-damnés (Robin Aubert, 2005) Capture d'écran
Saints-Martyrs-des-damnés (Robin Aubert, 2005) Capture d'écran
En 2005, tu interprètes le rôle de Tite fille, la muse poétique de Robin Aubert dans son premier film de genre St martyr des damnés. Tu as incarné quelques personnages comme celui-ci de nature plus fantastique…
C’est l’univers de Robin. Son scénario c’était excitant, étrange. Il y avait là dedans un peu d’horreur avec de la Science-Fiction, c’était hétéroclite.
Il y avait aussi cette idée que Tite fille ramassait des choses…
Elle joue de la guitare pour son troupeau de vaches.
Ça fait un peu Heidi.
Oui c’est vrai mais voilà, c’est son univers et moi j’adorais ça, c’était vraiment un beau personnage, qui ressemble à rien, un peu mystérieuse. On ne sait pas comment elle vit. On tournait vers Victoriaville à Notre Dame. Quand tu tournes ailleurs, tu es un peu comme dans une bulle.
On se souvient de plusieurs choses des scènes d’amour poétiques ou encore de ce dialogue « Pourquoi t’es belle ? Parce que c’est toi qui me regarde ». A ce niveau là, on peut dire que les metteurs en scène te font beaucoup de cadeau à ce niveau là. Des choses intenses, des personnages plutôt positifs…
Souvent, on est pris avec notre casting. Pour Borderline (Lyne Charlebois, 2008) par exemple, au départ ils ne voulaient pas de moi. Je ne pouvais même pas auditionner car elle avait offert le rôle à une autre actrice qui elle a refusé de le faire car c’était trop intense. J’avais rencontré l’autrice et j’avais eu une entrevue avec elle pour autre chose. Elle m’avait dit qu’elle écrivait des livres et qu’ils allaient faire un film, « deux de mes romans qu’on va mettre ensemble ». Je la regardais, c’était une petite blonde. On était un peu semblables. J’en parle à mon agent « Connais-tu ce projet ? » « Ben oui, ça a été offert, mais finalement, ça ne marchera pas donc elle va faire des auditions. » « Moi je veux auditionner, ça me parle ». Après l’avoir rencontrée, j’étais aussitôt allée acheter ses livres. Je les ai lus et j’ai trouvé ça intense, à la fois beau et poétique, et trash. Je me suis dit « ça c’est différent, je n’ai pas fait ça ». Mais finalement, elle ne voulait même pas me voir en audition. (rire) Elle s’imaginait une fille aux cheveux bruns, noirs, quelqu’un de trash cheveux noirs yeux noirs alors que l’écrivaine est complètement blonde, elle a l’air d’une poupée. Finalement, elle n’a pas trouvé, elle a eu une ouverture et j’ai insisté. J’y suis allé et finalement je l’ai eu. C’est drôle, comme quoi quand on persévère, des fois… Ça a quand même changé ma vie parce que c’était un gros rôle, très prenant et ça a été très intense.
C’est un rôle à risques.
Oui !
D’abord parce que pour le public populaire québécois qui te connaissais via la télévision, tu représentais quelque chose.
Bon, ça je m’en foutais un peu. J’assume complètement même si j’avais une peur bleue de tourner ça. J’étais très nerveuse, très stressée. C’était osé et en même temps intense mais j’assumais parce que je trouvais que ça servait complètement le propos. Ce n’est pas du tout du sexe qui te titille mais qui est important pour l’histoire.
Ça parle quand même de certains tabous qui entourent la sexualité féminine qui à l’époque n’étaient pas du tout abordé dans le cinéma québécois.
Et c’est malsain dans ce qu’elle est !
Pas toujours…
Pas à la fin, mais elle est dans une relation malsaine et ça il faut que ce soit montré. Alors je me disais « Mais comment on va faire ça ? » Je ne savais pas comment. J’avais peur mais finalement ça s’est bien passé.
Dans la partie où ton personnage a vingt ans, tu es beaucoup plus extravertie, en pilière de bar…
Oh oui !
 Isabelle Blais face à jean-Hugues Anglade dans Borderline (Lyne Charlebois, 2008)
Isabelle Blais face à jean-Hugues Anglade dans Borderline (Lyne Charlebois, 2008)
Avais-tu des choses à exorciser ou est-ce vraiment un travail de composition ? Puisais-tu dans ta folle jeunesse ?
Oui, c’est ça. Tu vas chercher en toi la partie qui peut ressembler à ça. À l’adolescence, j’étais un peu rebelle mais au contraire très introvertie. Je n’étais pas du tout comme ça. Donc là il m’a fallu regarder comment on peut plutôt être au théâtre. Je l’ai surtout vue comme un personnage. Mais bon, c’est pas toujours la joie là. Elle a une consommation de drogue un peu excessive. J’ai cherché la portion qui peut correspondre, même si ce n’est pas toi parce que justement, j’étais beaucoup plus tranquille que ça moi ! (rire)
Comment s’est passé le travail avec Jean-Hugues Anglade, qui lui avait une tradition de rôles un peu déshabillés et qui pouvait à la limite passer pour un sex symbol dans le cinéma français depuis 37°2 le matin ?
C’est ce qu’on m’avait dit mais moi je ne le savais pas. 37°2, c’est quoi ?
C’est Betty blue chez vous, avec Béatrice Dalle.
OK. En fait, je ne savais pas trop. « Ah ? Bon... Tant mieux, il va être à l’aise ! » Et en effet il était à l’aise, mais aussi très gentil. Il n’était ni déplacé, ni malaisant et c’était parfait comme ça. Et tant mieux parce que moi je l’étais moins, donc ça pouvait dégêner un peu, dans le sens de dire les choses aussi.
Comment Lyne Charlebois te présentait-elle les choses et t’amenait à te détendre par rapport à tout ça ?
Elle même était très nerveuse. Elle disait ce qu’elle voulait. Elle nous posait beaucoup de questions. « Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Qu’est-ce que tu veux que je ne te dise pas ? Veux-tu que je te dirige ? Que je te décrive tout ce qu’il faut faire ? » Malgré son angoisse, au moins elle me posait plein de questions. Comme ça, je me sentais écoutée. À ce niveau là, ça s’est bien passé et même si des fois, c’est improvisé et que tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. Ça m’a fait réaliser que dans les films, quand il y a de la sexualité, il faut que ce soit placé comme une bataille. Tu ne vas pas dire à deux acteurs « Allez, pétez vous la gueule, battez vous ! » Il va plutôt y avoir une chorégraphie pour que ça aie l’air vrai. Tu ne vas pas lui dire « Allez, lance lui une chaise à la figure et improvisez ! ». C’est la même chose avec les scènes d’amour. Tu ne connais pas l’autre, tu n’as pas fait l’amour avec, ce n’est pas vrai et en plus il faut faire semblant qu’on s’entende. Tu ne peux pas dire à des acteurs « Allez, laissez, vous aller ! »
En termes de mise en scène surtout parce qu’au niveau du scénario, on va plutôt tendance à le limiter et dire « là, scène d’amour ! »
Mais tu ne peux pas juste laisser les acteurs se débrouiller en disant « Faites là comme vous le sentez » mais plutôt « J’aimerais voir ci, voir ça et puis là... ». Il faut que ce soit dirigé.
Il y a une certaine sensualité dans sa mise en scène, un regard sur le corps en général, sur la femme… Un homme l’aurait traité très différemment et ça aurait été sans doute moins facile.
Tout à fait. Ceci dit le directeur photo était un homme et il était super respectueux et super discret. Mais ça a quand même aidé à me mettre à l’aise que Lyne soit une femme.
Tu as obtenu le Jutra et pas mal de prix pour ce film. C’est donc un grand moment dans ta carrière. Est-ce que ça a changé des choses avec le public ? Y a-t-il eu des spectateurs scandalisés, d’autres propositions de rôles difficiles où les metteurs en scène se disent « si elle est capable d’aller jusque là, proposons à Isabelle Blais ! » ?
Oui… mais non, moi je l’avais fait et je n’avais pas envie de retourner ça. Mais comme pour n’importe quel rôle en fait. On va toujours te redemander pour faire la même chose que là où on t’a vu en dernier ! « Elle fait bien la comédie » ou n’importe quoi. Donc là, c’était la même chose mais je me suis dit « Si on me repropose quelque chose du même genre, c’est non ! » En plus, c’était tellement intense que j’en avais assez comme ça. Souvent les journalistes me disaient « Oh mais c’est osé ! » Oui, mais quand vous regardez les résultats, il y a six scènes de sexe - ou au moins d’intimité - sur 91 ! Il y a beaucoup d’autres choses mais pourtant c’est ça qui marque.
C'est vrai que le cinéma québécois est parfois un peu prude…
Sans doute plus qu’ici. Mais en général, le film est bien passé car il y avait un vrai propos et le film n’était pas fait pour se rincer l’œil. (rire)
 Avec Laurent Lucas dans Sur la trace d'Igor Rizzi (Noël Mitrani, 2006) Capture d'écran
Avec Laurent Lucas dans Sur la trace d'Igor Rizzi (Noël Mitrani, 2006) Capture d'écran
Mais le film est important pour une autre raison, c’est le film de ta rencontre avec Pierre-Luc Brillant car dans Sur la trace d’Igor Rizzi (Noël Mitrani, 2006), je crois que vous n’aviez pas à proprement parler de scène ensemble, tu incarnais plutôt une sorte de muse silencieuse. La vraie rencontre c’est sur Borderline.
On ne s’était même pas vus et là par contre c’était un peu intense !
C’était l’inverse, le côté romantique du personnage.
Mais Sur la trace d’Igor Rizzi, c’était même carrément un rôle de fantôme. Un film porté à bout de bras et sans argent, avec Laurent Lucas. Je trouvais que c’était un beau film, mais ce n’était qu’une participation, une petite étoile qui arrive. Un ou deux jours de tournage, ce n’était pas trop accaparant.
Votre grand moment c’est donc Borderline.
Exact, mais après ça on n’était pas en couple donc on ne s’est pas reparlé pendant cinq ans ! On ne se connaissait pas vraiment, on avait ces scènes là à jouer. Après « Au revoir ! » On est repartis dans nos vies jusqu’à ce que cinq ans plus tard on joue ensemble au théâtre, une pièce qui s’appelait Midsummer (2012) et où il y avait des chansons. c’est ce qui a donné naissance à notre couple parce que nos relations respectives étaient terminées à ce moment là. Le timing s’y prêtait donc… Mais aussi on a joué ça où on était deux en scène durant 1h40 sans sortir, avec des chansons, plusieurs personnages. À un moment donné, la promiscuité des loges, le contexte fait que ça a commencé. c’est aussi ce qui a fait démarrer Comme dans un film, parce qu’avant nous avions chacun des groupes respectifs, mais on a vu qu’on travaillait bien en musique ensemble. Nos groupes étaient terminés, on avait dix ou douze ans de musique derrière nous, on a donc décidé de créer Comme dans un film.
Est-ce qu’un concert devant un public nombreux est plus intense pour toi qu’une scène courte mais forte à jouer ?
Les deux, c’est tellement différent. Si une scène d’émotion est très importante pour un film, c’est tellement stressant. Je suis tellement perfectionniste que j’exige de moi-même d’être là. Mais la vraie différence, c’est qu’au cinéma tu peux te reprendre. En scène, la relation est live, avec les gens. J’aime beaucoup la scène, autant en musique qu’en théâtre. c’est un dialogue avec le public et c’est tellement intense que j’adore ça.
 Tadoussac (Martin Laroche, 2017) Capture d'écran
Tadoussac (Martin Laroche, 2017) Capture d'écran
On peut aussi aborder le personnage de Myriam dans Tadoussac (Martin Laroche, 2017) et parce que je crois que de tous tes personnages, c’est celui que je préfère. Je ne sais pas s’il est principal ou pas mais en tout cas il est très touchant.
Surtout la scène finale. Quand j’ai lu ça, je me suis dit « Mon Dieu, quel défi ! », je veux trop faire ça.
Mais il y a aussi les scènes d’avant, celle où elle l’emmène à l’hôpital et celles de la rencontre où elle doit jouer un mensonge quand toi tu es plus naturelle. Comment s’est passé le travail avec Camille Mongeau ?
Elle est extraordinaire ! Je ne sais pas comment dire, c’est de la dentelle. Je trouve que dans un sens on est semblables. Tu la regardes et c’est tout en finesse. Je l’ai vraiment trouvée très bonne là dedans. C’était une belle relation, on ne se connaissait pas car elle est vraiment plus jeune. Elle a aussi des projets en tant que cinéaste, du documentaire, de la télévision. Et puis il y avait le réalisateur, Martin Laroche. j’adore quand tu pars en tournage et que tu te déracines. On tournait à Tadoussac en hiver, il n’y a personne. On est comme seuls au monde et on est vraiment en équipe. C’est une immersion et moi je trouve que ça m’aide beaucoup. Il ne faut pas non plus que ce soit trop long, j’ai aussi une famille. Mais ça m’aide à mieux performer.
Tu as bien trouvé ce personnage qui reconstruit sa vie, qui entre en résilience puis qui s’effrite petit à petit,se décompose. Comment imagines-tu la suite du film pour Myriam ?
Moi j’étais très positive. Elles vont se recontacter, se reparler. Je pense qu’il y a eu un pardon. Elle ne s’en souvient même pas mais elle s’est quand même sentie abandonnée. Ce que Myriam a fait, c’est grave, tragique. Mais moi je voyais comme de la lumière. Oui, ça peut se poursuivre...
Pour terminer, il y a deux projets plus modestes où vous jouez en couple avec Pierre-Luc mais très différemment puisque dans Le nid (David Paradis, 2018) vous n’êtes pas physiquement ensemble et Pas de chicane dans ma cabane (Sandrine Brodeur-Desrosiers, 2022). Exorcisez-vous vos peurs de couple ?
(rire) On était bons pour s’engueuler, pour s’obstiner, très très bons ! Ce sont un peu des caméos. On est là pour soutenir les jeunes. Il faut que la tradition de ces films là reprenne parce que les jeunes et les pré-ados ne se reconnaissent plus vraiment dans le cinéma. Mais nous on veut qu’ils regardent notre cinéma ! Je pense qu’il y en a de plus en plus mais je pense qu’avant on avait cette tradition, quand moi j’étais enfant, les Contes pour tous. C’était super à faire et on se servait un peu de notre vécu pour bien s’engueuler ou créer la tension. (rire)
Merci à Isabelle Blais et à toute l'équipe du festival Vues du Québec
 Avec Pierre-Luc Brillant dans Pas de chicane dans ma cabane (Sandrine Brodeur-Desrosiers, 2022) Capture d'écran
Avec Pierre-Luc Brillant dans Pas de chicane dans ma cabane (Sandrine Brodeur-Desrosiers, 2022) Capture d'écran