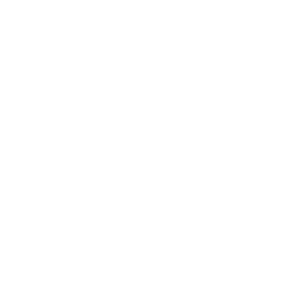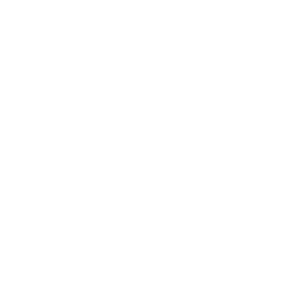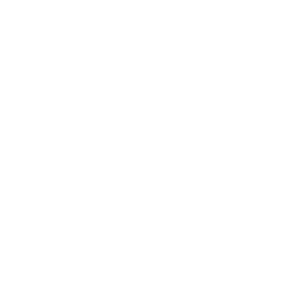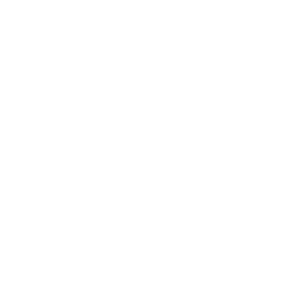- Partagez
- prev
- next
Entrevue de Mon cinéma québécois en France
« Choisir, cajoler, aimer beaucoup et longtemps » : Francis Leclerc ou la recette du film gagnant
entretien avec Pierre Audebert
Décalé, numérisé, puis mutilé d'une partie de ses invités et d'au moins une soirée, le festival 48 images seconde de Florac n'a pas pu présenter L'arracheuse de temps, le tout dernier film de Francis Leclerc alors en post-production. Mais cela ne les aura pas empêchés de présenter son grand classique Mémoires affectives, pourtant toujours inédit en France, un superbe thriller complexe et mélancolique où Roy Dupuis donne le meilleur de lui-même. En attendant la sortie au Québec ce vendredi 19 novembre de L'arracheuse de temps, une ambitieuse comédie fantastique adaptée de Fred Pellerin mais qui n'a pas encore de sortie prévue dans l'hexagone, il était grand temps de rencontrer Francis Leclerc pour évoquer 25 années d'une carrière exemplaire, entre le meilleur cinéma d'auteur et le plus beau cinéma populaire, lors d'une entrevue aussi riche que cinéphile et qui dévoile enfin ce qui fait son style unique !
 Francis Leclerc en promo-Droits réservés
Francis Leclerc en promo-Droits réservés
Dans l’attente de votre dernier film, L’arracheuse de temps (2021), on visionne en boucle la très belle bande-annonce de ce qui pourrait bien être votre film le plus ambitieux : un grand film d’époque fantastique et populaire. On imagine que c’est un des plus gros budgets québécois de l’année…
C’est certainement un des films les plus coûteux de l’année mais il ne faut pas se tromper avec le film de Sébastien Pilote qui vient de sortir, Maria Chapdelaine (2021), qui a obtenu deux millions de plus que nous l’année précédente car la sortie du film a été retardée par la pandémie et il est donc sorti en hiver. Au Québec, nous avons la tradition de faire un film d’époque tous les deux ans. Or ici, ça a été attribué à plusieurs cinéastes, ce qui est plus rare à cause du coût. Mais les québécois aiment beaucoup les films historiques... Dans ma filmographie, il y a quatre films d’époque sur cinq ! Si L’arracheuse de temps en est un, c’est avant tout un film fantastique et ça on n’en fait jamais au Québec. On a donc eu un bon budget, de près de huit millions de dollars canadiens et ça se voit à l’écran. C’est à ce jour le plus gros budget sur lequel j’ai jamais travaillé, même si j’ai quand même fait beaucoup de séries télé assez lourdes financièrement. C’est en tout cas mon film le plus ambitieux.
Malgré la pandémie, le calendrier a été respecté. Quelles difficultés et contraintes avez-vous rencontré ?
D’habitude, ce genre de films, on les tourne en un seul bloc, en trente jours ; en tout cas au Québec, il est très rare qu’on dépasse les quarante… Pour tous mes longs-métrages, mon record c’est 34 jours et c’était pour ce film. Mais la pandémie m’a avantagé car j’ai pu tourner en trois parties différentes. Il y a onze mois, en octobre dernier, on était en pleine préparation du premier bloc et pour le second, en pleine deuxième vague. Personne n’était vacciné donc il fallait maintenir la distanciation, deux mètres entre les comédiens. Le plus chiant dans l’affaire, c’était pour les moments où les comédiens étaient ensemble, dans un rayon d’un mètre, disons pour un two shot serré de deux personnes côte à côte ou quelqu’un qui parle très proche du visage de l’autre, par exemple comme pour le plan qu’on voit dans la bande annonce avec ces deux filles qui croquent une pomme. Ça, ç’a été fait en extérieur à l’automne lors du premier tournage. On avait droit à quinze minutes de rapprochement dans un rayon de deux mètres entre deux comédiens. Il nous a donc fallu calculer toutes nos prises de la journée avec ces mêmes comédiennes. Je ne connais pas les règles en France, mais ici, on allouait une durée de quinze minutes aux duos ou trios de comédiens. Une personne avait pour rôle de chronométrer chaque prise. Il déclenchait à « Action ! » et s’en allait dès que je disais « Coupez ! » On a réussi à faire le film malgré ces prises un peu plus limitées que d'habitude. Donc tous les extérieurs ont d’abord été tournés en octobre. Puis on a fait le gros des intérieurs en studio au printemps, avec des mesures assouplies, toujours ces quinze minutes mais là on pouvait avoir plusieurs comédiennes dans la même bulle et donc y aller carrément en groupe, ce qui m’a beaucoup servi. Et puis on a tourné le dernier morceau, tout ce qui est magasin général, les scènes de foule autour d’un tournoi de cartes. Là, j’ai tenu à ce qu’on puisse mettre quatre personnes par table et qu’elles puissent parler parce qu’à ce moment là il n’y avait plus la restriction des quinze minutes. C’était il y a tout juste deux mois et ça a été super de pouvoir faire ça en dernier, sinon je pense que je ne l’aurais pas fait. Ça nous aurait été impossible à faire au printemps et encore moins à l’automne. Tout ça a finalement été un avantage pour ma préparation ou plutôt pour les trois préparations ! Ce que je fais pour tous mes longs-métrages, c’est de tout story-boarder. Mais ici comme il y avait beaucoup d’effets spéciaux, je l’avais fait avec six mois d’avance pour certaines séquences. Le film a donc bénéficié de cette longue préparation sur mon temps personnel, que je ne chiffre évidemment pas. Bref, j’ai passé 130 jours à le préparer au lieu de 40 ! Je pense qu’on s’en rend compte en le voyant et que le film est plus abouti et maîtrisé techniquement, que l’argent a été utilisé aux bons endroits pour chaque plan, avec une direction photo soignée et une direction artistique très poussée. Voilà, ça sort bientôt !
 Francis Leclerc au travail - Droits réservés
Francis Leclerc au travail - Droits réservés
Comment qualifieriez-vous l’univers de Fred Pellerin pour les français qui ne le connaissent pas tous?
Fred va souvent en France et je pense qu’il est bien apprécié par un certain public. Il aime les petites salles et jouer devant un public avec qui le dialogue est possible. Il se sent proche des gens tout comme au Québec. L’univers de Fred est tellement régional qu’il est exportable, dans le sens où les gens se reconnaissent à travers ses histoires de famille du passé. Je pense que le passé de nos grands-parents ou arrière grands parents doit beaucoup se ressembler. Les films français des années 20 m’ont toujours autant fasciné que ceux du Québec. Il y a une grande relation entre les deux. Outre la langue, il y a tout le côté commentaire qui peut aussi se retrouver en France. Un conteur, c’est un conteur et j’ai l’impression que dans un village, tout le monde a un curé, un tenancier de magasin général ou un coiffeur. C’est très universel. Mais c’est vrai que la langue, le québécois parlé par Fred, est moins accessible pour les français. Il y a toujours cette barrière à sens unique et on ne reviendra pas sur ce vieux débat selon lequel il faudrait sous-titrer nos films, mais je peux comprendre que le Fred Pellerin parlé peut être très complexe à comprendre.
Comme vous le faisiez remarquer, le film d’époque revient souvent chez vous. Déjà, Une jeune fille à la fenêtre se passait dans le Québec des années 20… Y a t-il un goût de l’histoire et des vieilles choses qui vous vient de votre héritage familial ?
C’est ça. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré par les années vingt, je pense que c’est le hasard qu’Une jeune fille à la fenêtre (2001), Pieds nus dans l’aube (2017) et L’arracheuse de temps se passent tous trois en 1927. Je pense que pour L’arracheuse de temps, je l’ai fait exprès. Ça aurait pu être en 23 ou en 29, d’ailleurs même Fred ne le sait pas car pour lui ce n’est pas important, même si c’est écrit dans les résumés du film. C’est d’époque car c’est la vie des grands-parents et arrière grands-parents. C’est peut-être aussi un clin d’œil à mes deux films précédents. Mais c’est probablement un héritage familial car mon père est né en 1914. Mon père, c’était Félix Leclerc. Sa jeunesse s’est passée dans les années vingt ce qui a probablement eu des répercussions sur moi. Sans doute que s’il avait eu vingt ans de moins, j’aurais fait des films dans les années trente. Dans son héritage écrit ou chanté par rapport à sa propre jeunesse, mon roman préféré était Pieds nus dans l’aube donc ces années là m’ont marqué assez jeune. J’ai aussi étudié dans le vieux Québec… C’est ce qu’il y a de plus vieux chez nous. J’aime ce côté citadin du Québec de 1927. Une jeune fille à la fenêtre, c’est l’histoire d’une fille de la campagne qui s’en va à Québec pour étudier le piano. Il était donc tout à fait normal que je tourne mon premier long-métrage à cet endroit là, avec d’un côté le milieu rural, de l’autre la ville. Je pense que faire un premier long-métrage d’époque avant mes trente ans a été déterminant pour moi. J’ai pu rapidement comprendre tous les problèmes posés par un film de ce type : les carrioles, les chevaux, cette complexité à laquelle s’ajoute l’emploi des chiens et des animaux de ferme. Et aussi l’amour des robes d’époque et de tenues vestimentaires que je trouve très payantes à l’écran. J’aime beaucoup le cinéma qui nous fait voyager dans le temps. C’est agréable d’être contemporain, mais quand on peut s’offrir un voyage dans le temps en le contrôlant, en ouvrant cette petite fenêtre sur ce que devait être Québec ou Saint-Elie-de-Caxton en 1927, c’est comme si on était des magiciens.
 Nos étés (2005)
Nos étés (2005)
Une jeune fille a contribué à imposer Fanny Mallette. Vous la retrouverez dans le télé-roman à succès Nos étés (2005-2008). Quel souvenirs gardez-vous de ces collaborations avec celle qui est devenue une des toutes meilleures actrices du Québec ?
À l’époque où je lui ai fait passer le casting, j’avais vu Les muses orphelines (Robert Favreau, 2000) l’année précédente, qui avait été pour moi une véritable révélation. J’ai vu une vingtaine de comédiennes pour cette audition. À l’instant où elle a passé le pas de la porte, elle n’avait même pas ouvert la bouche que pour moi dans ma tête c’était elle. C'était notre premier long-métrage à tous les deux, enfin pour elle, celui où elle avait le rôle principal. Dans Les muses orphelines, son rôle était important mais tout ne reposait pas sur lui. Même si j’avais fait des films pour la télévision, beaucoup de courts-métrages dont quelques uns d’époque, là c’était vraiment la totale. Après ça, on est restés amis pendant 25 ans mais c’est vrai que je l’ai retrouvée peu de temps après pour Nos étés.
Ça a été un énorme succès…
Oui ! Pour faire le lien avec ma fascination pour le film historique, il y a deux grandes séries qui m’ont marqué à l’adolescence : Les filles de Caleb (1990) réalisée par Jean Beaudin…
… avec déjà Roy Dupuis !
Oui. Et puis la suite, Blanche (1993), réalisée par Charles Binamé avec Pascale Bussières. J’ai beaucoup d’admiration pour ces deux cinéastes, en particulier pour ces deux œuvres là. Faire des films en costume à la télévision a été une révélation pour un ado amoureux de cinéma comme moi. C’était fascinant de suivre Les filles de Caleb chaque semaine. Comme tout le monde j’y ai découvert Roy Dupuis et Roy fait depuis partie de mon cinéma, s’il n’est pas dans presque tous mes films. C’est quelqu’un d’important dans mon cheminement. Il est peut-être lié à ces souvenirs d’adolescence où je le trouvais excellent comédien. Là on parle nostalgie mais on va certainement en reparler ! (rires) Fanny, Roy ou Céline Bonnier sont des comédiens phares pour moi. Ils reviennent aussi bien au cinéma qu’à la télévision. Ça nous permet de travailler ensemble, de nous améliorer et les liens sont encore plus forts lorsqu’on se retrouve sur les films. J’ai fait de la télévision avec tous ces acteurs là, comme avec Fanny Mallette pour Mensonges (2014-2018), une série télé policière où elle tenait le rôle principal et c’était un bonheur de la retrouver. Il n’est pas exclu qu’on se revoie dans un avenir proche pour un projet futur. J’aime retrouver tous ces comédiens avec lesquels je partage une passion et avec qui j’ai une facilité de communication.
 Mensonges (2014)
Mensonges (2014)
C’est aussi le début d’une fructueuse collaboration avec votre chef opérateur Steve Asselin qui se poursuit jusque dans les séries télé. Je ne sais pas s’il était déjà là pour vos clips et courts-métrages... (il acquiesce) Comment fonctionnez vous tous les deux ? Vous parliez de votre habitude de tout story-boarder, mais y a-t-il quand même une marge de liberté ou d’improvisation qui lui est laissée ?
Steve est un peu plus jeune que moi, il a 47 et moi j’ai 50 ans demain ! On s’est connus dans la vingtaine et il a appris le cinéma avec moi. Il était machiniste, puis chef machino sur des clips. On est très rapidement devenus amis. Je ne cache pas que c’est même mon meilleur ami. On a vraiment créé un univers, puis on a évolué ensemble. Une jeune fille à la fenêtre était son tout premier long-métrage. On était les deux plus jeunes de tout le plateau à ce moment là. On s’est donc entourés d’expérience, évidemment avec des plus jeunes. Si on a appris ensemble, Steve, lui, contrairement à moi, totalise trente longs-métrages car c’est un directeur photo assez demandé ici. Il fait partie des directeurs photo majeurs du Québec, parmi les cinq qui font le plus de films dans leur carrière. Il touche aussi à la série télé et on en a fait beaucoup ensemble. C’est quelqu’un qui épouse bien la vision d’un réalisateur, tout en étant capable d’amener une touche bien à lui.
En fait, c’est un grand maître de la lumière. Dès qu’il y a des nuits d’époque ou un éclairage particulier, c’est là qu’il est à son meilleur, dans le sens où tout directeur photo recherche des projets comme ceux-là. Je ne l’ai jamais vu aussi heureux sur un plateau que pour L’arracheuse de temps, parce que là il avait les moyens d’éclairer plusieurs nuit. Le récit étant situé sur une nuit, il y avait beaucoup de tournage nocturne. Je trouve qu’il est au sommet de son art en ce moment car c’est probablement le film le plus maîtrisé qu’il aie fait ici. Et ça, ça n’arrive pas quand tu as 22 ans ! C’est à cet âge qu’il a débuté ; il a d’abord fait 80 % de mes courts. C’est enfin quelqu’un avec qui on a appris à aimer le cinéma en voyant des films ensemble jusqu’à aujourd’hui, où on regarde encore beaucoup de films en vue des prochains. Et je partage plein d’autres choses avec lui, autant la vie familiale que l’amitié et le cinéma. Dans mon milieu, c’est la personne la plus importante pour moi depuis que je fais du cinéma. J’aime aussi le perdre de vue pendant six mois ou un an quand il part travailler sur un autre long-métrage parce que c’est toujours très agréable lorsqu’on se retrouve ! Il sera aussi sur le prochain long qu’on est en train de préparer pour janvier-février-mars. D’ailleurs je pense qu’il aime travailler avec moi car je suis bien préparé. J’arrive avec des propositions, des story-boards mais je suis toujours le premier sur le plateau à changer d’idée quand lui en a une meilleure. Par rapport au blocking, la mise en place avec les comédiens, si j’ai un squelette de cinq ou six plans bien préparés mais que c’est plus efficace en trois plans, alors on va le faire en trois plans. Ou à l’inverse, s’il faut en rajouter un, on le fait ! Mais il aime bien épouser ce que je propose, avoir étudié mon découpage quelques jours avant, puis arriver pour le faire et là, toujours trouver la meilleure solution pour mieux faire.
 L'arracheuse de temps (2021) Capture d'écran
L'arracheuse de temps (2021) Capture d'écran
C’est donc quelqu’un qui a de la place mais ne va pas non plus faire mon découpage à ma place. Pour moi, c’est important qu’il fasse son vrai métier de directeur de la photographie et pas celui du réalisateur, chose qui arrive souvent quand on fait de la télévision ici au Québec où le directeur se ramasse le découpage technique à faire parce que le réalisateur est occupé à régler les problèmes du lendemain ou du surlendemain. Je préfère nettement le rythme du cinéma, même si la télévision m’a bien servi dans la vie et que j’ai beaucoup aimé en faire. Mais il n’y a rien de mieux que d’avoir de vrais échanges avec son directeur photo sur des films où là on peut travailler, parler lumière et que moi je m’occupe de mes comédiens. Le cadre est déjà établi donc il peut se focaliser sur la lumière. Je travaille de la même manière avec les autres directeurs photo avec qui j’ai tournés.
Pour vous qui veniez du clip et saviez déjà travailler vite, le passage à la télévision s’est-il fait naturellement ?
Oui, ç’a été pour moi un atelier d’apprentissage extraordinaire et j’y ai découvert un tas de techniciens de mon âge qui m’ont suivi après et jusqu’à aujourd’hui. Pour nous, le clip était un laboratoire de création et le réalisateur est investi à 100 % dans la conceptualisation. On créait vraiment le concept de A à Z. Souvent l’artiste avait une vague idée et nous on l’adaptait pour en faire un clip. Mais moi j’ai toujours privilégié le récit. J’en ai fait beaucoup, une quarantaine ou une cinquantaine, mais en privilégiant l’histoire, souvent avec des comédiens en parallèle. Même en trois minutes, j’aime raconter une histoire. Les concepts trop abstraits, je n’ai jamais aimé ça, ce n’est pas ce qui m’habitait. Pour faire la genèse de mes débuts, ça a été mon école puisque je n’en ai pas fait. J’ai d’abord étudié la communication à l’université Laval de Québec. Je suivais des cours en cinéma mais sentant très rapidement que je n’allais pas faire de film à cette université, je l’ai quittée avant d’avoir obtenu mon diplôme et à 21-22 ans, je suis parti faire des courts-métrages. C’était peut-être un drôle de rêve vu qu’à l’université, mes professeurs me disaient : « Tu ne feras jamais de cinéma ». C’est super comme encouragement… Mes mentors, les cinéastes que j’admirais beaucoup, ça a été Yves Simoneau et François Girard qui tous les deux étaient de Québec. Si ces deux là faisaient du cinéma au moment même où mes professeurs me disaient que je n’en ferais jamais, je ne comprenais pas cette phrase ! Ça ne rentrait pas dans ma tête puisqu’ils venaient du même endroit que moi. Yves a croisé mon parcours pour Marie-Antoinette (2006) en 2005-2006 et François Girard a fait partie de ma vie à mes débuts parce qu’il était conseiller à la scénarisation sur Une jeune fille à la fenêtre. J’ai beaucoup de respect pour ces gars là. Aujourd’hui encore, ils sont importants pour moi. Ils ont dix ou quinze ans de plus que moi mais je les ai suivis et j’aime beaucoup leur trajectoire. J’ai beaucoup d’admiration pour eux. On peut aussi rajouter André Mélançon qui est arrivé un peu plus tard.
 Marie-Antoinette (2006) Capture d'écran
Marie-Antoinette (2006) Capture d'écran
Tous vos films ont été très bien accueillis mais là, ça va s’emballer très vite avec Mémoires affectives (2004) qui a cette particularité d’être à la fois un thriller et un film dramatique (il acquiesce). Or si je le compare aux films québécois que j’ai vus, je lui trouve un ton et un style assez atypique. Il tire son suspense de l’ambiguïté infusée à chaque personnage. Un film où Roy Dupuis trouve sans doute son plus grand rôle. Comme c’est un acteur qui aime s’immerger dans ses personnages, comment l’avez vous préparé à affronter ce personnage d’amnésique ?
Ça a été mon premier film avec lui et c’est pour nous deux le plus marquant. On travaille depuis dans une confiance mutuelle car ce film était très complexe et Roy est la personne qui dès le départ, a le plus cru au projet. Il y a bien eu trois ou quatre ans d’attente avant de pouvoir le faire. Pour moi, c’était important dès le départ que ce soit lui, surtout après notre première rencontre. C’est quelqu’un de très intelligent et il comprend très bien le sens d’un film. Mais avec lui, il faut savoir où tu vas. Le diriger, oui, mais si le réalisateur ne sait pas ce qu’il veut, ça le dérange. Il ne faut pas faire n’importe quoi, tout doit être justifié. Pour Mémoires affectives, il a beaucoup préparé le personnage d’Alexandre Tourneur dans le sens où il m’a beaucoup posé de questions ! Il m’a obligé à me positionner pendant ma préparation et à arrêter d’être flou sur certains points. Je suis quand même conscient que le film reste très flou (rires), que ce n’est pas facile à comprendre, mais c’est comme cela que je l’ai voulu. Tout le monde a un peu son interprétation du film, même si le scénariste Marcel Beaulieu et moi, on avait la nôtre. Mais j’aimais bien que les gens nous sortent n’importe quelle théorie. Mon Dieu qu’un film peut voyager et porter des propositions de compréhension différentes ! Roy et moi, on a compris le même film et on l’a suivi de A à Z. A ce jour, je crois que c’est un des films dont il est le plus content. Il le confirmera probablement… C’est aussi la dernière fois dans ma vie que j’ai hésité à faire du cinéma car c’était pour moi une période très difficile parce qu’après un film réussi mais peu vu comme Une jeune fille à la fenêtre, faire le second c’est ce qu’il y a de plus difficile dans la vie et pas seulement pour moi, mais pour plein d’autres cinéastes, quelque soit leur âge ou l’époque. Il a été encore plus difficile de convaincre les gens de faire un film que personne ne comprend. J’ai fini par y arriver avec beaucoup de persévérance et après beaucoup de réécritures, ce qui m’a forcé à être plus clair dans ma trame et ce, même si en le faisant j’ai décidé volontairement de ne pas l’être !
Au montage, j’ai décidé de tout changer parce que je le trouvais plus intéressant déconstruit. Dans toute l’introduction du film, on ne comprend absolument rien à ce montage parallèle avec l’animal, le chevreuil, le vétérinaire, la tempête de neige et la présence du frère, mais c’est fascinant. Ça c’était une idée du directeur de la photo Steve Asselin. On avait tout tourné pour que ce soit dans l’ordre dans les boîtes et là il est arrivé après le tournage avec une proposition de montage dans laquelle il avait tout cassé. C’est là que je me suis dit, il faut casser le film complètement. Il n’y a donc pas un seul flash back que j’ai mis à la bonne place. Tout le monde a fait ça d’instinct. Le monteur Glenn Berman et ça a donné quelque chose de spectaculaire. Moi je n’avais rien à perdre puisque je voulais continuer ce métier. Mémoires affectives a fait que je devienne un vrai cinéaste et plus seulement un réalisateur qui va peut-être gagner sa vie. J’avais 33 ans et je me demandais si j’allais continuer ou non. Suite au film, j’ai eu des offres de la télévision, ce qui m’a permis de faire autre chose que du clip, ce qui ne payait pas vraiment. J’ai donc commencé à la télévision et Nos étés est arrivé, à a cause de Mémoires affectives et de la maîtrise d’un autre long-métrage d’époque. J’ai donc réalisé un de mes rêves d’adolescent et fait une série historique à la manière de Charles Binamé ou de Jean Beaudin. Nos été a été le déclencheur de plusieurs projets télévisuels ultérieurs. Mémoires affectives aura donc été un coup de dés dans le sens où je jouais gros, un pari risqué qui m’a permis d’y gagner une signature, un style aux yeux du public et peut-être du respect du milieu du cinéma, dans le sens où je ne faisais pas des films comme les autres. J’ai pu me démarquer...
 Mémoires affectives (2004) Capture d'écran
Mémoires affectives (2004) Capture d'écran
Vous aimez faire bouger votre caméra, amorcer un rythme pour emballer la scène. Cette mobilité semble être un autre héritage de vos années clip, une approche formaliste du cinéma ?
Oui… J’ai toujours aimé les cinéastes comme Jim Jarmusch, Tarkovsky ou Truffaut mais je trouvais qu’ils ne bougeaient pas (rires). Jarmusch est toujours fixe. Le film où ça bouge le plus, c’est Night on earth parce qu’il est dans un taxi. Même si la perspective bouge, le cadre est fixe et le plan se finit par un fondu au noir. Son cinéma est très hermétique et très drôle mais ça me manquait… J’ai toujours aimé les cinéastes qui n’ont pas peur de prendre la caméra et de bouger avec leurs comédiens, les suivre ou au moins les attendre. J’aime cette mobilité donc pour Mémoires affectives, j’ai vraiment choisi mes moments où bouger, décider de tourner caméra à l’épaule ou pas. J’ai toujours été un grand fan de travelling, des longs dolly. Alors, j’y ai fait vraiment des mouvements étranges, avec en plein milieu des changements de focales. J’ai fait plein de choses et ça a donc été comme un gros laboratoire. (rire) Mais ça, ça vient en effet du clip d’essayer plein de trucs, d’enlever les lentilles au milieu du tournage, de déclipser autre chose, de faire des effets optiques que tu ne peux pas faire dans les films. J’y ai parfois emprunté des procédés pour les amener dans mes films. Je choisis aussi des effets qui vont bien vieillir comme pour Pieds nus dans l’aube, qui est très classique et dans lequel rien ne vient du clip. C’est aussi parce que c’est un film plus calme, plus contemplatif donc la caméra ne bouge pas beauxcoup et je filme très peu à l’épaule, ce n’était pas l’idée ! De par son récit, L’arracheuse de temps bouge plus car il y a plus d’action et de péripéties. Certes, j’adore les trois cinéastes que j’ai cités, mais aussi d’autres plus obscurs pour le commun des mortels, comme Jean-Jacques Annaud parce qu’il ne fait jamais un film pareil ou aux États-Unis Sidney Lumet, parce qu’il y a une économie de musique et qu’il sait bouger la caméra. Ses films sont tous différents et il ne travaille jamais avec les mêmes personnes. C’est aussi un cinéaste engagé par rapport aux luttes et aux combats de ses personnages principaux donc j’adore son cinéma. Plus haut que tout, je mettrais probablement quelqu’un comme Coppola parce qu’il a fait du cinéma commercial, du cinéma intime, des films pour lesquels il a joué sa vie ou sa chemise. Ce sont des cinéastes totalement investis. Je mets Coppola plus haut que Scorsese ou Spielberg. Je les aime tous mais il y a une telle audace ! Son trajet est aussi particulier car il a aussi fait des mauvais films et ça c’est correct ! J’aime ses choix dangereux ! (rires) Je les cite sans trop réfléchir mais ça fait vraiment partie de mon cheminement par rapport aux films. On a beau aimer Tarkovsky sans tout y comprendre quand on est ado, ou Bergman, ça reste lent et contemplatif. Or moi je n’aurais pas le goût de ne faire que ça dans la vie.
Vous avez parlé de la déstructuration du récit de Mémoires affectives au montage, mais qu’est-ce qui était prévu dès le tournage ? Il y a beaucoup de plans très courts donc ça fait aussi plus de travail et d’installation pour toute l’équipe...
(il acquiesce) Oui, en fait chaque flash back était prévu. Si on regarde le story-board sur le papier, tout le film y est. C’est juste qu’on l’a brassé, complètement mélangé. Il était déjà déconstruit mais on l’a reconstruit comme un jeu de Lego, avec deux possibilités. Des fois on achète un jeu de Lego et on a l’impression qu’il y a le vaisseau que l’on peut monter mais qu’il y en a aussi un autre qu’on peut créer, puis un autre et ainsi de suite… Le vaisseau que j’avais préparé était beau mais pas assez... (il cherche le mot) spécial. En le déconstruisant, j’en ai créé un meilleur ou plus intéressant. C’est la première fois que j’utilise cette métaphore. J’ai l’impression que Mémoires affectives était un jeu avec plusieurs petits morceaux, complexes à assembler mais qui ont un lien entre chacun d’entre eux et au bout du compte, ça fonctionne. Là où je pense avoir échoué, c’est dans la continuité du récit. Ne pas perdre les gens de vue. J’ai l’impression que l’espèce de concept autour du souvenir volé n’est vraiment pas clair. Aussi, le film n’est pas réussi à cause de son scénario. L’aspect technique et la réalisation sont supers mais le film y aurait gagné si j’avais été plus attentif à la continuité. C’est bien beau de déconstruire, mais à un moment il ne faut pas perdre son monde. Ce qui est étrange, c’est que les gens ont quand même suivi ! Mon Dieu, les gens aiment-ils donc ne pas comprendre ?
 Roy Dupuis dans Mémoires affectives (2004) Capture d'écran
Roy Dupuis dans Mémoires affectives (2004) Capture d'écran
C’est, je crois, un film qui gagne à être revu, en tout cas, moi, plus je le vois, plus je l’aime. Nous obliger à une réflexion nous implique d’autant dans l’expérience du film.
C’est intéressant parce que j’ai des techniciens d’une vingtaine d’années qui travaillent actuellement avec moi sur des séries télé et qui me parlent du film qu’ils ont vu à l’école ou à l’université comme étant un de leurs préférés pour différentes raisons, ce qui prouve vingt ans plus tard, que le film vieillit bien. En général, mes films vieillissent bien, y compris Une jeune fille à la fenêtre, parce que ce sont avant tout des récits avec des comédiens qui, je l’espère, sont bien dirigés. C’est pour ça que j’embarque dans des nouveaux projets : une bonne histoire avec des bons comédiens.
Après un tel succès, vous tournez avec Yves Simoneau un film sur Marie-Antoinette pour une coproduction avec la France. C’est assez osé de faire un film sur ce personnage historique toujours très controversé et de le faire réaliser par deux québécois ! On imagine qu’il y a eu aussi pas mal de difficultés liées au tournage dans des lieux patrimoniaux. Quelle a été la réception côté français ?
Je ne sais pas vraiment. Ça a été une drôle d’aventure mais j’ai beaucoup aimé fabriquer le film avec Yves. On avait quinze jours pour faire un film d’1h20 pour la télévision, donc ce fut un apprentissage et une expérience incroyable, d’autant qu’on a tout fait sur fond vert. Tous les décors ont été filmés à Versailles et autres châteaux avec juste des plates, des fonds. Avec Guy Dufaux, le directeur photo d’Yves Simoneau, on a fait le tour des châteaux. Moi même j’ai fait pas mal de plans avec une autre caméra. Pour Versailles, on y a eu accès tous les lundis durant trois semaines pour filmer des lieux entièrement vide et ça c’est vraiment fascinant d’être là alors qu’il n’y a personne, que les femmes de ménage et nous. Ça a aussi été une belle expérience côté technique, pour apprendre comment ça marche avec le green screen. En 2006, ce n’était pas comme la technologie d’aujourd’hui. Faire un film entier comme ça a fait de nous des précurseurs. Mais Yves a toujours été un précurseur dans son cinéma ! J’ai beaucoup appris avec ce gars là, et avec beaucoup de plaisir. Mais le résultat français est complètement différent du montage québécois puisqu’en cours de route, les producteurs français nous ont forcé à changer la voix off. La nôtre était une voix off de type internationale faite par Guy Nadon qui est un grand comédien ici. Les français sont même allés jusqu’à en réécrire complètement le contenu. Nous n’avons donc pas eu le director’s cut pour la France. Je n’ai vu cette version qu’une seule fois et je l’ai trouvée épouvantable (rires).
 Marie-Antoinette (2006) Capture d'écran
Marie-Antoinette (2006) Capture d'écran
Yves et moi on voulait montrer une Marie-Antoinette humaine, un peu de gauche (je rigole), qui voit la vie différemment, comme une jeune fille dépassée… C’est devenu une œuvre de droite, (rires) vue par une femme bien à sa place, qui a fait les bons choix au bon moment. Mon Dieu, ce n’étais pas du tout le même film ! On a complètement perdu le contrôle du produit final. Il quand même eu un vrai impact au Québec. Notre version est un point de vue de deux québécois sur Marie-Antoinette et tout un pan d’histoire française. C’était déjà audacieux de le faire. J’avoue avec le recul que je m’étais lancé dans une affaire dont j’ignorais tout. Je faisais beaucoup confiance à Yves et je ne regrette pas du tout de l’avoir fait. Mais je trouve l’œuvre française travestie, pas du tout intéressante et après, de toute ma carrière, je pense que ce n’est vraiment pas la chose la plus intéressante que j’ai faite, même si ça m’a beaucoup servi techniquement et que ça m’a amené à retravailler avec beaucoup de ces techniciens. J’y ai appris à me servir un peu mieux de mes outils. Et cette nouvelle boîte à outils m’a notamment ouvert la porte de la publicité, puisque j’ai fait beaucoup de spots complexes techniquement. On m’appelait pour n’importe quel projet de green screen. Avec ça, j’ai bien gagné ma vie de 2007 à 2010 et même, jusqu’à 2013. J’ai tourné beaucoup de pubs, puis j’ai arrêté parce que j’en avais fait le tour, c’est quand même moins intéressant. Un projet amène toujours un autre projet, puis un autre, et un autre… J’ai donc l’impression que c’était important de faire Marie-Antoinette même si le contenu n’est pas intéressant.
Qu’est ce qui vous a séduit dans le livre de Marc Robitaille dont vous avez tiré Un été sans point ni coup sûr (2008), sur cet enfant fan de base ball? L’époque ? L’envie de faire un film de sport ?
Pas du tout le film sportif ! C’est plutôt l’envie d’un récit père-fils car Mémoires affectives en était un autre mais celui-là, trouble, pas du tout serein puisque les deux frères ont eu un père terrible. On peut dire que j’ai tué mon père dans Mémoires affectives et là j’avais envie de faire « J’aime mon père » avec Un été sans point ni coup sûr. Ce que j’aime dans ce roman, c’est que ce n’est même pas un héros, juste un petit gars de douze ans, pas très bon au base-ball. Il ressemblait à moi plus jeune : quelqu’un qui veut être capitaine de son équipe, jouer avec ses amis, mais de là à faire carrière… Ben non ! Ce n’est pas du tout un drame sportif mais plutôt familial, avec en fond le sport et l’été au premier plan. Mais j’aime beaucoup les drames sportifs. L’unité que ça donne, surtout avec les sports d’équipe. Avec ces neuf joueurs, la psychologie sportive est encore plus intéressante, surtout à cet âge là. L’art de savoir perdre, celui de gagner. C’est peut-être basique, mais il y a quelque chose de très beau et très noble dans ce récit là. Le roman en tant que tel est très illustré, il y a beaucoup d’images, de cartes de base-ball, de photos… C’est très biographique, très Marc Robitaille. De sa jeunesse, j’ai voulu aller vers quelque chose qui ressemblait à la mienne, soit dix ou quinze ans plus tard, pour explorer une autre époque, la fin des années soixante, 1969. C’était un autre univers et un défi supplémentaire.
 Pierre-Luc Funk dans Un été sans point ni coup sûr (2008) Capture d'écran
Pierre-Luc Funk dans Un été sans point ni coup sûr (2008) Capture d'écran
Mais mon plus grand défi, ça a été de ne travailler qu’avec des jeunes. Il y a bien des adultes très importants dans le film mais tout tourne autour du petit Martin joué par Pierre-Luc Funk qui est encore quelqu’un d’important pour moi au même titre que Roy ou Fanny Mallette avec laquelle je travaille encore. On peut voir Pierre-Luc dans la bande-annonce de L’arracheuse avec une perruque ridicule, c’est mon hommage aux Visiteurs ! J’ai vraiment voulu qu’à ce moment là, il ait l’air aussi ridicule que Jacouille. Je le retrouve donc treize ans plus tard même si on s’est croisés à la télévision. C’était vraiment le premier film de Pierre-Luc, Jean-Carl Boucher, Simon Pigeon. Hier, ils étaient tous là pour mon anniversaire, ce qui montre qu’une amitié qui commence à douze ans est encore importante aujourd’hui. Il y avait aussi Ricardo Trogi que vous connaissez bien. On est vraiment des bons amis dans la vie même si Ricardo et moi, on est quinquagénaires. Cette continuité entre nos œuvres et vraiment importante et entre amis, on en parle beaucoup. C’est important de respecter d’autres cinéastes comme Ricardo ! J’aime beaucoup son cinéma. Pour nous, c’est une grande et très intéressante famille. Donc Un été sans point ni coup sûr, c’est la famille qui continue et s’élargit avec des enfants en plus. Entre Mémoires affectives et Un été sans point ni coup sûr, j’ai moi-même eu un garçon, donc l’ouverture à l’enfance s’est faite, plus en parler peut-être… Je trouve là un passage vers Pieds nus dans l’aube qui est l’aboutissement de cette réflexion par rapport à l’enfance de mon père. Tout ça est peut-être très instinctif, mais faire ce chemin jusqu’à Pieds nus dans l’aube est venu très naturellement,avec une démarche un peu plus sérieuse et très intime par rapport à mon père, comme de reprendre un autre personnage de garçon de douze ans, cet âge avant l’adolescence que j’aime beaucoup, où le préadolescent ne comprend pas du tout ce qu’il fait ou du moins, où comme le disait Truffaut, découvre tout pour la première fois. Douze ans est pour moi l’âge le plus intéressant à filmer.
Vous aimez les collaborations et travailler avec d’autres metteurs en scène. Le court-métrage Trotteur (2011) co-réalisé avec Arnaud Brisebois était un projet avec des moyens, de l’ampleur et du style où on retrouve certains mouvements de caméra, le montage elliptique, les ralentis, des figures qui vous sont proches. Beaucoup d’émotion... Que pensez-vous avoir apporté à ce projet très personnel écrit, strory-boardé et porté par Arnaud Brisebois et comment vous partagiez-vous le travail ? D’ailleurs, comme pour le film avec Yves Simoneau, comment se répartit-t-on lorsqu’on travaille à deux metteurs en scène ?
Les deux sont très différents… Pour Yves, il était impossible à un réalisateur seul de passer quinze jours sur le green screen et de tourner toutes ces scènes. Ça a été très drôle car on a décidé que je faisais les scènes paires et lui les impaires (rire). Donc on a vraiment divisé ça au hasard, de sorte que dans la journée je pouvais faire mes deux scènes paires et lui les siennes. Pendant qu’il tournait les paires, moi je préparais la scène suivante, puisque nous n’avions que quinze jours et qu’il fallait être très rapides, ce qui fait que chacun assistait l’autre réalisateur au moment même où nous tournions la scène. On avait tout story-boardé ou plutôt comme on dit « shotlisté ». Tout dessiner sur fond vert n’est pas nécessaire, mais on avait fait un découpage écrit que nous avions tous deux lu et quand venait le temps de mettre en scène la scène paire, j’y allais alors qu’Yves se mettait derrière les consoles, car nous avions plusieurs caméras et c’était très technique, donc il m’assistait dans ce moment là. Ensuite, c’était l’inverse. Le deuxième réalisateur s’occupait aussi de l’arrière-plan, pendant que le premier gérait l’avant-plan. Ça a donc été un partage complet. Certes, Yves était plus établi. Il avait beaucoup plus d’expérience que moi. Mais il m’a laissé ma place à part égale et ça, je lui en serai toujours reconnaissant. Il m’a vraiment laissé travailler. C’est qu’il avait beaucoup aimé Mémoires affectives et souhaitait vraiment travailler avec moi et pas avec n’importe qui. Il aimait mon cinéma et mes deux premiers films. Je crois qu’il s’est aussi reconnu en moi, un gars de Québec qui voulait faire du cinéma. Enfin, j’avais aussi beaucoup fait de films d’époque. Au fond, on partage les mêmes goûts.
 Trotteur (2011) Capture d'écran
Trotteur (2011) Capture d'écran
Arnaud, lui, était à ce moment là un directeur artistique d’effets visuels. D’ailleurs dans L’arracheuse de temps, tout ce qu’on voit de visuel vient de lui. La direction artistique était assurée par Jean Babin qui était aussi sur Un été sans point ni coup sûr. Je suis assez fidèle à mes collaborateurs. J’ai fait aussi beaucoup de publicités avec Arnaud. En dix ans, il devenu incontournable au niveau mondial. Son cv est très impressionnant. Il travaille sur des films comme Fantastic four, Paddington, puis Blade runner 2047 et Premier contact avec Denis Villeneuve. Il a quand même trouvé le temps de faire L’arracheuse de temps cette année ! C’est notamment lui qui a conceptualisé et dessiné le personnage de la mort, de même qu’il avait imaginé son Trotteur en 2011. C’est après voir dirigé les effets spéciaux d’Un été, dont ceux du générique, qu’Arnaud Brisebois est venu me voir et m’a dit : « J’aimerais réaliser un film et j’ai une idée ». Souvent les gens ont une idée mais ça n’aboutit jamais. Lui a été sérieux. Il m’a apporté les huit pages de son histoire, qui m’a beaucoup intéressée. Il avait besoin de moi pour la mettre en scène et pour monter son financement, car il avait encore peu d’expérience de la réalisation. Il n’avait jamais dirigé de comédiens de sa vie et il fallait réunir une équipe crédible. Il ne suffit pas d’avoir été directeur d’effets visuels durant treize ans pour pouvoir faire un film. On ne te fera pas confiance pour mettre autant de temps et d’argent dans un film. Ceci dit, il n’a pas coûté très cher car il a embarqué toute la gang de Mokko la compagnie où il travaillait, puis les producteurs sont arrivés, pour faire ce film presque bénévolement. On dirait que le film a coûté 500 000 dollars, alors qu’il n’en a coûté que 120 000, ce qui est quand même pas mal pour un huit minutes ! À peu près personne n’a été payé, mais c’étaient cinq jours de tournages très agréable à faire et très remplis, très techniques. Sans Marie-Antoinette, je n’aurais pas fait Trotteur et sans Arnaud, je n’aurais jamais eu une direction artistique éclatante et belle avec des effets spéciaux aussi poussés pour L’arracheuse de temps. Ce sont donc une accumulation d’expériences et d’amitiés qui font en sorte que j’arrive à L’arracheuse de temps cette année et plus tard, à autre chose… Mon but n’est pas de grossir et d’être de plus en plus ambitieux mais de faire le meilleur projet possible avec les gens que j’aime. Je pense que vous voyez mieux maintenant que tous les films sont liés. Et c’est Steve Asselin qui a assuré la photographie de tout cela.
La relation filiale est encore au cœur de Pieds nus dans l’aube, adapté d’un livre autobiographique de votre père écrit dans les années quarante. Est-ce difficile de prendre de la distance quand on parle de sa famille ?
Oui ! Pour moi, ça a été mon film le plus difficile à faire. Mais il fallait que je le fasse ! Dès la vingtaine, alors que je commençais à tourner des courts-métrages, je m’étais promis que si je continuais encore longtemps à faire des films, il faudrait que j’adapte Pieds nus dans l’aube à la quarantaine. Il y a dix ans jour pour jour, j’avais donc commencé le synopsis de l’adaptation. Ma force n’a jamais été dans le dialogue. C’est entre autres pour cela que j’aime bien travailler avec des co-scénaristes, comme Marcel Beaulieu pour Une jeune fille à la fenêtre et Mémoires affectives. Là, ça nécessitait quelqu’un qui avait une couleur donc j’ai appelé Fred Pellerin, non pas pour écrire du Fred Pellerin mais pour écrire du Félix Leclerc. Je pense que la filiation poète-conteur entre mon père et Fred est très facile à comprendre et je le connaissais assez bien pour pouvoir lui demander et il a accepté très courageusement, sans avoir l’assurance de faire le film, mais l’a fait admirablement. C’est devenu un ami et quelqu’un avec qui on se fait confiance mutuellement. C’est pour ça qu’il m’a offert de faire L’arracheuse de temps. Encore une fois, tout est lié ! Sans Pieds nus, pas d’Arracheuse ! Mais j’ai toujours dit que c’était une thérapie à 5,3 millions, car moi j’ai toujours voulu parler de mon père autrement que l’artiste que tout le monde connaît. Pour moi, c’était Félix avant Félix. Le petit Félix. C’était important de le voir à douze ans, de choisir un acteur qui ressemblait à mon père à cette époque, de lui peindre une famille similaire à la sienne. Il n’était pas important d’être exact en tout. C’est une adaptation, mais les cinq ou six scènes fortes du roman sont dans le film. Mais on s’est aussi fait plaisir et on en a créé d’autres.
 Pieds nus dans l'aube (2017) Capture d'écran
Pieds nus dans l'aube (2017) Capture d'écran
C’est probablement le seul film que je ferai sur mon père. Tout le côté Félix Leclerc à Paris, ses débuts dans les années 50 ne m’intéresse pas du tout. Enfin, je suis content pour lui que ça ait existé et que ça ait été important pour sa carrière, mais de là à en faire un film… J’ai passé toute ma vie à vouloir me détacher de mon père comme beaucoup de fils par rapport au leur. Comme c’était un artiste connu, c’était doublement compliqué. Ça a été comme de refermer un grand livre. « Bon, je peux passer à autre chose ! ». De l’idée à la livraison, ça aura pris dix ans pour faire Pieds nus dans l’aube. Mais c’est un passage obligé que je ne regrette pas du tout. Je suis content car encore une fois, ça m’amène à un autre point de ma vie. Le film réunissait aussi beaucoup de choses que j’aime : le récit, l’époque, beaucoup de comédiens auxquels je suis fidèle. Je jouis d’une grande liberté pour mes films ici au Québec. J’ai vraiment un contrôle absolu sur le choix des comédiens, des techniciens et sur la mise en scène. Plus qu’à la télévision, ce qui est normal. Les producteurs me laissent vraiment travailler comme je l’entends, dans une complicité avec eux bien sûr. C'est important pour moi cette amitié partout. On voit toujours les producteurs comme les méchants, mais ce n’est pas du tout le cas. Ce sont des gens très importants et on doit sans cesse les remercier, car c’est grâce à eux qu’on finit par faire des films aussi personnels et importants dans nos vies.
Avec un personnage de légende comme Félix Leclerc, y avait-il beaucoup d’attente au Québec autour de ce projet, et même une certaine pression ?
(hésitant) Oui… Mais en même temps, j’avais confiance. C’est comme pour L’arracheuse de temps où on sent que les gens veulent le voir. Mais j’ai vu le film plusieurs fois et je sais que les gens vont l’aimer. Ce dont je ne suis pas sûr, c’est s’ils vont l’aimer vraiment beaucoup ou juste l’aimer et point. Il y a une génération qui a adoré Pieds nus dans l’aube, celle des soixante ans et plus. Il y a eu beaucoup de salles combles. Pour les fois où je suis allé le présenter en Europe, je suis allé à Madrid et la salle en était remplie. Ce sujet est universel et on dirait que les sexagénaires aiment beaucoup revenir à cette époque et y retrouver leurs parents. Ça a donc bien marché auprès d’eux, moins avec les jeunes de vingt ans. Pour L’arracheuse de temps, je devrais réunir les mêmes plus les moins de cinquante ans ou en tout cas, un peu plus, les rejoindre grâce à la parole de Fred Pellerin sur son versant le plus accessible, plus que pour Pieds nus. Ceci dit, mon but n’est pas de plaire à tout prix, mais seulement de faire des bons films, même si on est toujours contents si plus de monde vient le voir. Il est vrai que quand j’écrivais Mémoires affectives, j’étais bien conscient que ça ne parlerait pas à tous les québécois. Mais il est tout aussi important de réaliser ces projets là. En ce moment, je fais sans doute des films plus grand public, mais ça peut changer.
 Pieds nus dans l'aube (2017) Capture d'écran
Pieds nus dans l'aube (2017) Capture d'écran
Comme dans Un été, il y a dans Pieds nus un portrait plus chaleureux de la famille. Cette harmonie vient du regard que porte Félix adulte. Mais vos oncles et tantes en auraient peut-être brossé un tableau moins idyllique. Tout est vécu du point de vue de Félix qui a bénéficié d’un soutien assez étonnant de ses parents…
En fait, je n’ai jamais aimé les biopics parce que généralement la famille est impliquée dans le projet et préfère le plus souvent cacher les côtés les moins beaux de la personne. Là, c’était pour moi un an dans la vie de Félix, de ce petit garçon et non de Félix Leclerc. Vis à vis du roman, j’ai été fidèle au bonheur qu’on y retrouve, la fidélité entre frères et sœurs, cette espèce de convivialité entre les parents qui se habite tout le livre. Peut-être que le film souffre justement d’un manque d’adversité, si ce n’est la mort de cette villageoise qu’on ne connaît pas dans leur village. Ce n’est peut-être pas mon film le plus fort dramatiquement parlant parce qu’il manque un combat du personnage principal. De même que pour Un été sans point ni coup sûr, il n’était pas question de traiter le grand combat d’un garçon de douze ans, mais de bâtir une équipe A. Il ne l’aura jamais faite, mais a trouvé l’équipe B. Il n’y a pas eu de suicide dans sa famille cet été là, ni de maladie. Il s’agit de films très simples en comparaison du contenu plus grave de Mémoires affectives ou de certaines séries télé que j’ai faites, qui étaient plus conflictuelles. Ces deux là peuvent être perçus comme des films très gentils, mais moi je trouve ça bien de les faire ces films là ! Les jeunes de douze ans ont aussi, à leur échelle, leurs drames. Il n’y a pas d’obligation d’y mettre des meurtres, des gens qui s’entretuent ou la maladie, pour en faire des bons films. Le pari, c’est d’émouvoir avec des histoires très simples. L’épreuve de cet été là, c’est de dépasser la mort d’un cheval plus que celle d’un frère. Ces histoires là ont aussi leur place.
Un point que vous partagez avec votre ami Ricardo Trogi…
Ricardo est plus axé sur le côté « Divertis moi, fais moi rire ! », mais en même temps il y a quand même une profondeur véritable. Les films de Ricardo marchent tout le temps, preuve qu’il touche du doigt les bonnes choses et qu’il sait rejoindre un immense public. Il ne le fait pas exprès, il est juste fait comme ça et c’est tout à son honneur.
Qu’est-ce qui vous motive tant à toujours revenir vers la télévision : les projets proposés ? L’aspect économique dans le sens où ça vous donne du temps pour préparer vos films sur du plus long terme ? Ou plus simplement le goût du travail avec les acteurs et une plus grande proximité ?
C’est un peu tout ça. Il faut savoir qu’il est impossible de gagner sa vie ici en ne réalisant qu’un long-métrage tous les quatre ans. Vient alors le moment de choisir quoi faire à côté : « Est-ce que j’enseigne le cinéma au CEGEP ou à l’université ? Est-ce que je vais continuer à tourner des clips toute ma vie ? » Non, ce n’est plus tellement tendance et il y a tellement moins d’argent que par le passé. On est surtout dans une ère de réseaux sociaux, moins cinématographique et moins intéressante pour un gars de cinquante ans comme moi. L’autre option, c’est de faire de la publicité et ça, j’en ai déjà fait énormément pour gagner ma vie. J’y trouve un plaisir technique, pécunier, mais aucun plaisir créatif ou si peu. À un moment donné, c’est lourd de faire douze campagnes publicitaires par an et tu n’as plus l’impression de créer, mais d’enchaîner les commandes. J’ai totalement arrêté parce que je peux me le permettre. La télévision a été un bon compromis pour gagner ma vie, tout en ayant du plaisir à diriger des comédiens et voir ma famille s’élargir avec de nouveaux techniciens, de passer beaucoup de temps entre amis à créer une œuvre. Les projets que j’y ai adaptés m’ont aéré l’esprit parce que c’étaient des trucs que je n’aurais jamais écrit moi-même, comme par exemple des scénarios très comiques ou au contraire, très denses et sombres. J’ai donc exploré ici la mise en scène avec des comédiens de grand talent. La télévision m’a permis de devenir un meilleur directeur d’acteurs et un meilleur réalisateur.
 L'arracheuse de temps (2021) Capture d'écran
L'arracheuse de temps (2021) Capture d'écran
J’ai moins le goût d’en faire ces derniers temps parce que plus ça va et moins on a d’argent. Il faut aussi aller plus vite et ça, ça m’intéresse moins, surtout depuis L’arracheuse de temps où j’ai eu tout le loisir de ne tourner que deux pages par jour quand à la télévision, on en fait quinze ! Ça donne une idée du rythme. Tous les réalisateurs le confirmeront : il est beaucoup plus agréable de se retrouver sur un long-métrage à quatre pages par jour. On entend même des horreurs avec certains qui tourneraient jusqu’à 45 pages par jour ! C’est absurde ! Ce n’est plus le même métier, tu ne parles plus avec les comédiens. C’est juste de la régie et ça, ce n’est pas intéressant. Ça m’a beaucoup plus de faire de la télévision et ce, jusqu’à très récemment. Là, je laisse un peu aller histoire de voir arriver la qualité des textes. Écrire pour la télé est une tâche beaucoup trop complexe pour moi, trop difficile. Par contre, j’adore écrire un long-métrage en quatre ou cinq ans avec certains collaborateurs. Mais la télévision m’a d’abord permis de très bien gagner ma vie. Pourtant, ça m’aurait plus d’avoir une filmographie à la Coppola, à la Sidney Lumet ou à la Scorsese qui font un film tous les deux ans et en ont les moyens. Aux États-Unis, ils ne font presque pas de télévision, ou alors dans les années cinquante ou soixante, des téléfilms qui leur ont servi de formation. Aujourd’hui, les cinéastes se tournent vers Netflix et consorts pour monter leurs projets. J’aurais adoré parler des quinze films de ma filmographie mais non… La télévision a fait que j’ai réussi au moins à faire mon métier convenablement. Les cinéastes québécois à quinze films sont très rares. Déjà, avec un sixième en route, je me sens vraiment privilégié.
Il y a chez vous un attrait pour le cinéma de genre : le thriller, la comédie fantastique. Les rescapés (2011-2012) touche aussi à la Science-Fiction. Il y a eu depuis quelques beaux succès québécois internationaux avec Robin Aubert ou Patrice Laliberté, même si le film de genre ne marche pas forcément dans les salles. Avez-vous déjà eu d’autres projets de gros film de genre au cinéma ?
C’est que le public ne suit pas nécessairement. Le film d’horreur de Robin a marché mais je ne pense pas qu’il s’y attendait. Les films de zombies plaisent aux plus jeunes. Robin est un ami et j’adore son audace. Il a aussi fait des films très différents, tout comme moi dont en particulier ici, pour le film d’époque comique, un genre peu pratiqué. C’était nouveau pour moi, même si ça mêle le genre historique que j’ai souvent abordé aux séries comiques que j’ai tournées. C’est un amalgame de ces genres dont j’ai beaucoup appris. Quand j’étais jeune, j’aimais Les visiteurs qui est très comique. Quand on le regarde aujourd’hui, tout est tellement monté trop rapidement, hachuré et en fait, mal raconté, au point qu’on ne se souvient au bout du compte que de la performance des comédiens. Je ne dis pas que L’arracheuse de temps a à voir avec Les visiteurs, mais alors pas du tout ! C’est comme pour Kaamelott que j’ai vu il y a un mois. C’est difficile de réussir un comique qui soit touchant, même si j’ai l’impression qu’Astier a quand même réussi son pari. En tout cas, ces films là aident à ce que les nôtres se fassent et soient différents de ce que nous tournons habituellement au Québec. On a une grande tradition de films très dramatiques, des huis-clos ou de comptoirs de cuisine, des films un peu ruraux où la vie est lourde. J’essaie un peu de me battre contre cela. Ce n’est pas que je n’aime pas ces films, mais je n’ai pas envie d’en faire. J’ai le goût d’aller voir ailleurs. Mais je serai ravi de faire un film de Science-Fiction. J’adore ça, sauf que c’est une question de coût et de faisabilité. Un jour peut-être…
 L'arracheuse de temps (2021) Capture d'écran
L'arracheuse de temps (2021) Capture d'écran
Trouver les fonds, c’est déjà une problématique. Réussir son film en est une autre. Mais au Québec se pose aussi le problème de la distribution. Comment un gros budget comme L’arracheuse de temps sera-t-il distribué en salle, c’est à dire dans quel circuit, combien de salles et combien de temps tiendra t-il l’affiche, sachant que d’autres films à succès ont eu leur carrière écourtée pour cause de pandémie ?
Le problème canadien est que le reste du Canada ne s’intéresse pas du tout à notre cinéma et nous nous intéressons très peu au leur. Les deux solitudes, c’est très vrai. Toronto, c’est déjà un autre pays, comme je l’ai encore constaté le mois dernier. Ça n’a rien à voir avec Montréal. C’est à la fois une barrière linguistique et culturelle. On a l’avantage d’avoir notre propre culture et de rester dans nos frontières, vu que le peu d’exportations qu’on a, trop limitées selon moi, se fait vers les pays francophones comme la France. On ne va jamais faire une tournée à Toronto, Vancouver, Calgary avec L’arracheuse de temps, on n’y songe même pas. En fait, je nous vois un peu comme le Danemark !
Ceci dit, le festival de Florac invite Matthew Rankin cette année, un anglophone qui tourne au Québec. Alors peut-être que les deux solitudes, ça commence un peu à se tasser…
Oui, mais son film n’est pas vu par le public québécois. C’est à dire que les cinéastes se connaissent et peuvent se parler entre eux, se respecter. Il y a autre chose que Cronenberg ou Egoyan au Canada anglais, mais nous n’avons pas accès à leurs films. Ils ne sont pas distribués chez nous, même sur les plate-formes ! Il faut vraiment être cinéphile et fouiller, donc ce n’est pas pour monsieur et madame Toutlemonde. Au Québec, nous avons quand même un système de distribution qui fonctionne, mais beaucoup trop de films en même temps, en plus du problème de la pandémie. Personnellement, j’ai toujours été content de la distribution de mes films. Pour Une jeune fille à la fenêtre, j’avais été déçu qu’il ne marche pas plus. Je parle pour l’époque, 2001, d’un box office de 100 000 dollars. Par malchance, le film est sorti quinze jours après le 11 septembre ! Personne ne voulait voir mon film et tout le monde est allé à Amélie Poulain. Ça, ce n’était pas super ! Avec Mémoires affectives, j’ai gagné beaucoup de prix, ce qui fait que le film est ressorti en salles et à cette époque on pouvait plus compter sur le box-office. J’ai du faire pas loin de 800 000. Un été sans point ni coup sûr, c’était quand même bien, d’autant que le base-ball n’était pas à la mode à ce moment là, donc dans les 800 000 là aussi. Enfin, un peu décevant mais les gens avaient beaucoup aimé. Par contre, Pieds nus dans l’aube a quand même été le troisième film le plus vu cette année là, toujours avec 800 000 ! On dirait que c’est ma jauge.
C’est sûr que j’aimerais que L’arracheuse de temps fasse le double, à cause de Fred Pellerin et du côté plus commercial que tous les autres films que j’ai réalisés jusqu’ici. En tout cas, mes films ont été vus, pas autant que ceux de Ricardo ou d’autres cinéastes avec qui vous avez du jaser, mais au moins les gens se déplacent plus que pour beaucoup de cinéastes québécois dont les films ne sont vus que par une poignée de personnes et ne font que 5000 dollars de recettes. C’est terrible ! Ce n’est pas assez. Je me sens donc privilégié que les gens se déplacent pour voir mon dernier film. Mais est-ce que ça va continuer ? Je suis plutôt pessimiste par rapport à la salle. Tout le monde reste chez soi, tout le monde aime Netflix, même si je ne comprends pas trop pourquoi. Il me semble quand même que dans une salle, on est enfin dans les conditions idéales. Il faut continuer à aller voir des films ! Or, j’ai l’impression que les gens s’en sont lassés et le home cinéma ne nous aide pas. Même moi, à la campagne je suis bien équipé ! Je regarde souvent des vieux films. Bref… Je pense que c’est un problème mondial et pas seulement québécois. Je me désole aussi que les films français n’arrivent plus jusqu’à nous. On voit seulement vos comédies ridicules (rires) et c’est dommage de n’avoir accès qu’à des films que tu aimes moins que toi-même. Alors avec les plate-formes, on se rabat sur ce qu’on peut. Au temps de l’âge d’or du cinéma français ici, c’est à dire durant les années 80-90, tous les québécois étaient allés voir Cyrano ! Ça n’arrive plus et c’est triste. Notre cinéma québécois a pris beaucoup de place sur le marché et le cinéma français s’est tassé, enfin c’est ma théorie ! Pas assez de salles, trop de films américains à grand déploiement et qui nous mangent complètement. Là, on sort en même temps que Ghost buster, alors est-ce que les familles iront voir celui-ci plutôt que L’arracheuse de temps ? Je ne sais pas encore… C’est quand même un milieu très déficitaire et très coûteux. C’est très dur, aussi je suis vraiment content d’avoir réalisé cinq films jusqu’à présent !
 Francis Leclerc 2021
Francis Leclerc 2021
Pour finir, y a-t-il dans votre carrière des projets qui n’ont pas encore aboutis, mais que vous pourriez tourner plus tard ?
Très peu. Il y en a eu auxquels je me suis intéressé et qui ont connu des premières versions de scénario, mais je me suis rendu compte très rapidement que ce n’était pas ça. Des projets pour lesquels on m’a contacté et qui m’intéressaient... Pour faire un film au Québec, il faut vraiment travailler dur, être complètement convaincu du sujet, réécrire et à un moment donné, le sujet te lâche lui-même. Il n’y a pas non plus beaucoup de projets dans mes cartons. J’en ai qui vont se faire, comme d’ailleurs la plupart des projets auxquels je touche. Parce que je les choisis, je les cajole, je les aime beaucoup et longtemps. Je travaille depuis quatre ans sur Le plongeur, un roman de Stéphane Larue que je tourne cet hiver, donc je suis sûr que ça va se faire. Ça a été quatre ans de travail de scénarisation avec Éric Boulianne, futur jeune cinéaste québécois que vous connaissez (j’acquiesce), qui est un grand scénariste. Il n’a que la trentaine et est vraiment impressionnant. j’espère que Le plongeur va aussi être un film important pour lui, puisque le roman a beaucoup marché ici et même fait son bout de chemin en langue anglaise. J’ai encore l’impression de faire un film d’époque, puisque ça se passe en 2002. Il y a beaucoup de chose à penser pour revenir vingt ans en arrière, mais c’est une jeunesse que je comprends parce que je l’ai connue. Pour moi, c’est un nouveau défi et puisqu’on parlait de genre, c’est un drame autour d’un jeune de 19 ans, au début de l’âge adulte donc, dans un univers montréalais froid, obscur ou avec très peu de soleil et quelque chose de beaucoup plus grave à traiter. Je le fais à peu près avec la même équipe que L’arracheuse de temps alors que c’est totalement à l’opposé ! Ça me fascine que Steve Asselin s’en aille faire une toute autre sorte de lumière, qu’on prenne la caméra différemment et que je fasse un autre type de découpage, jusqu’à la mise en scène. Faire des choses différentes m’habite beaucoup. Je pense que si on m’avait dit de faire un autre film historique avec des carrioles et des chevaux, là j’aurais refusé. J’en ai refusé des séries comme ça, je ne peux quand même pas filmer que des filles en robe dans des carrioles ! Il faut se changer la tête et ne pas avoir peur d’adapter des sujets qui ne nous ressemblent pas ou qu’on n’aborde pas. On est là pour creuser et analyser l’être humain, ses réactions et raconter des histoires différentes. Je suis un cinéaste comme ça. Les cinéastes que j’admire et dont j’ai parlé aiment s’attaquer à des sujets différents et je veux être de ceux qui touchent à plusieurs choses. Ça ne sera peut-être pas réussi tout le temps, mais au moins j’aurais essayé.
Remerciements : Francis Leclerc, Guillaume Sapin (Festival 48 images seconde)